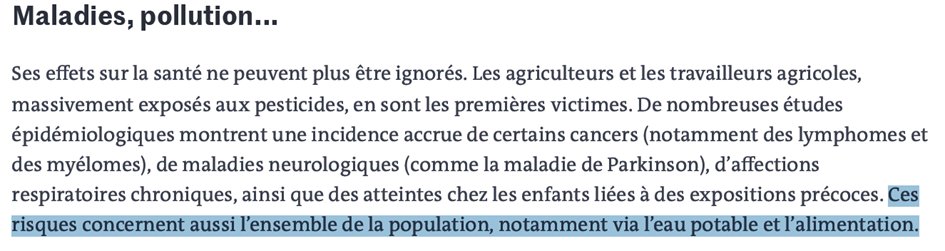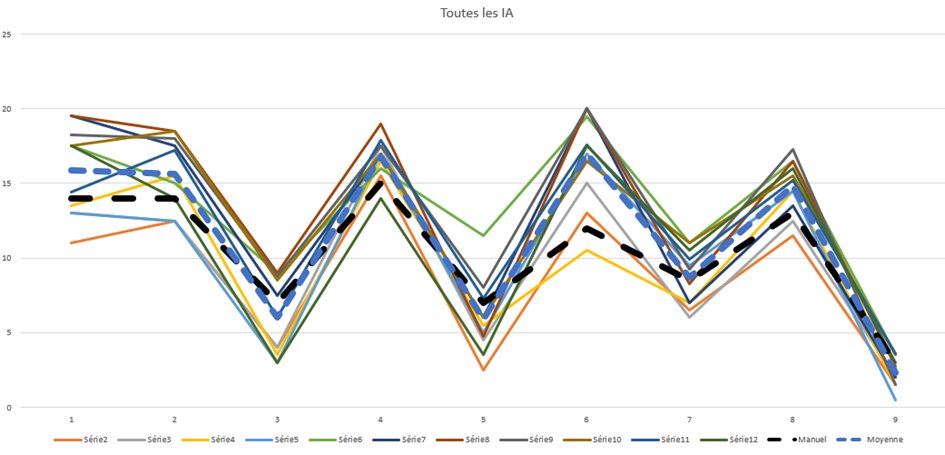Aujourd’hui, pas de sujet polémique, mais je vous propose d’évoquer un sujet passionnant et mystérieux : le métabolisme des plantes.
Pourquoi en agriculture est-il si important d’incorporer des légumineuses dans les rotations de cultures ? (1/n)
⬇️⬇️⬇️
Pourquoi en agriculture est-il si important d’incorporer des légumineuses dans les rotations de cultures ? (1/n)
⬇️⬇️⬇️
Les plantes, comme tous les êtres vivants chlorophylliens, n’ont pas besoin de « manger » car elles font de la photosynthèse.
Ce processus permet de créer de la matière organique à partir de la lumière du Soleil, d’eau et de CO2. (2/n)
Ce processus permet de créer de la matière organique à partir de la lumière du Soleil, d’eau et de CO2. (2/n)
Mais cette photosynthèse a une limite : elle ne permet que de créer des glucides, des molécules composées uniquement de carbone (C), d’oxygène (O) et d’hydrogène (H). Ces glucides peuvent être convertis en lipides sans problème car les mêmes éléments sont présents dedans. (3/n)
MAIS, elle ne permet pas de créer les protéines car celles-ci contiennent en + de l’azote (N).
Du coup, nos amies les plantes sont obligées de se dégotter une source d’azote dans leur environnement. Et ça, ce n’est pas toujours évident. Il y a en gros 3 sources possibles : (4/n)
Du coup, nos amies les plantes sont obligées de se dégotter une source d’azote dans leur environnement. Et ça, ce n’est pas toujours évident. Il y a en gros 3 sources possibles : (4/n)
-En général, les plantes trouvent l’azote dans le sol sous forme d’ions (ions ammoniums NH4+, ions nitrates NO3-). Ces ions se créent grâce aux décomposeurs qui mangent la matière organique qui leur tombe dessus et qui en retour relarguent ces ions dans le sol. (5/n)
-Parfois, les sols sont particulièrement pauvres en décomposeurs (milieux anoxiques), comme dans les tourbières par exemple. Dans ce cas, il n’y a pas suffisamment d’ions azotés dans le sol. (6/n)
Mais certaines plantes arrivent à s’adapter quand même en assimilant des sources d’azote chez les animaux.
C’est le cas… Des plantes carnivores. (7/n)
C’est le cas… Des plantes carnivores. (7/n)
-La dernière source d’azote possible, et qui constitue un réservoir inépuisable, c’est… l’atmosphère. L’air est en effet composé aux ¾ de diazote (N2). (8/n)
Le pb c’est que le N2 est très difficile à métaboliser car la triple liaison présente entre les 2 atomes d’N est très costaude. Les seuls organismes qui arrivent à réduire le diazote en NH3+ métabolisable sont des bactéries, grâce à une enzyme très spéciale : la nitrogénase (9/n)
Sauf que certaines plantes arrivent à coopérer avec ces bactéries : elles les hébergent dans leurs racines dans de petits nodules : les nodosités racinaires. (10/n)
Elles leur refilent plein de sucres (faciles à créer en masse grâce à la photosynthèse), et en échange, les bactéries leur fournissent de l’azote sous forme de NH3+.
Ces plantes, ce sont les légumineuses (trèfles, luzernes, féveroles, soja, pois…). (11/n)
Ces plantes, ce sont les légumineuses (trèfles, luzernes, féveroles, soja, pois…). (11/n)
Ces légumineuses ont donc à leur disposition une source d’azote inépuisable, ce qui leur donne un avantage conséquent dans la survie. Mais elles ont aussi un rôle écologique important car elles permettent d’apporter une source d’azote dans l’écosystème. (12/n)
Dans les champs cultivés, la matière organique est exportée pour nourrir les populations ou le bétail. Du coup, de l’azote est exportée aussi et quitte le système. Il est ainsi nécessaire d’importer une source d’azote pour que le sol continue à être fertile. (13/n)
Pour cela, on a en gros deux moyens :
-Epandage de matière organique (fumier, lisier, mulch,…) qui sera consommée par les décomposeurs qui relargueront en échange des ions azotés. (14/n)
-Epandage de matière organique (fumier, lisier, mulch,…) qui sera consommée par les décomposeurs qui relargueront en échange des ions azotés. (14/n)
-Epandage d’engrais de synthèse contenant des nitrates qui pourront être directement assimilables par les plantes.
Dans les deux cas, ces fertilisants peuvent provoquer des problèmes écologiques. (15/n)
Dans les deux cas, ces fertilisants peuvent provoquer des problèmes écologiques. (15/n)
Sauf que si on intègre des légumineuses dans la rotation des cultures, celles-ci vont assimiler directement l’N de l’atmosphère, et permettront de limiter la quantité de fertilisants à apporter.
D’où l’importance de ces plantes dans les techniques agro-écologiques. (16/n)
D’où l’importance de ces plantes dans les techniques agro-écologiques. (16/n)
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh