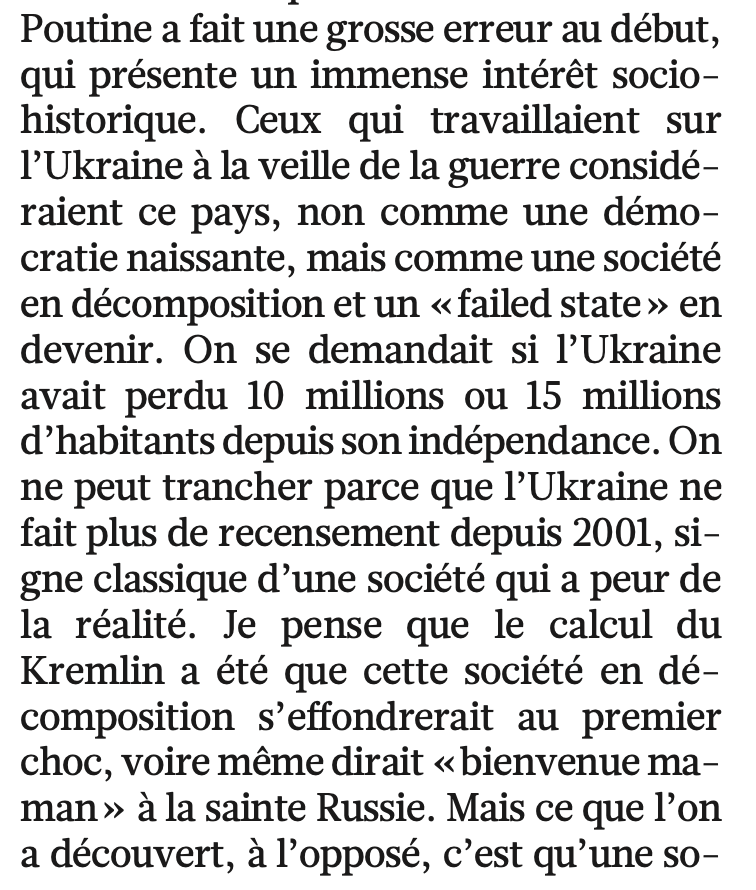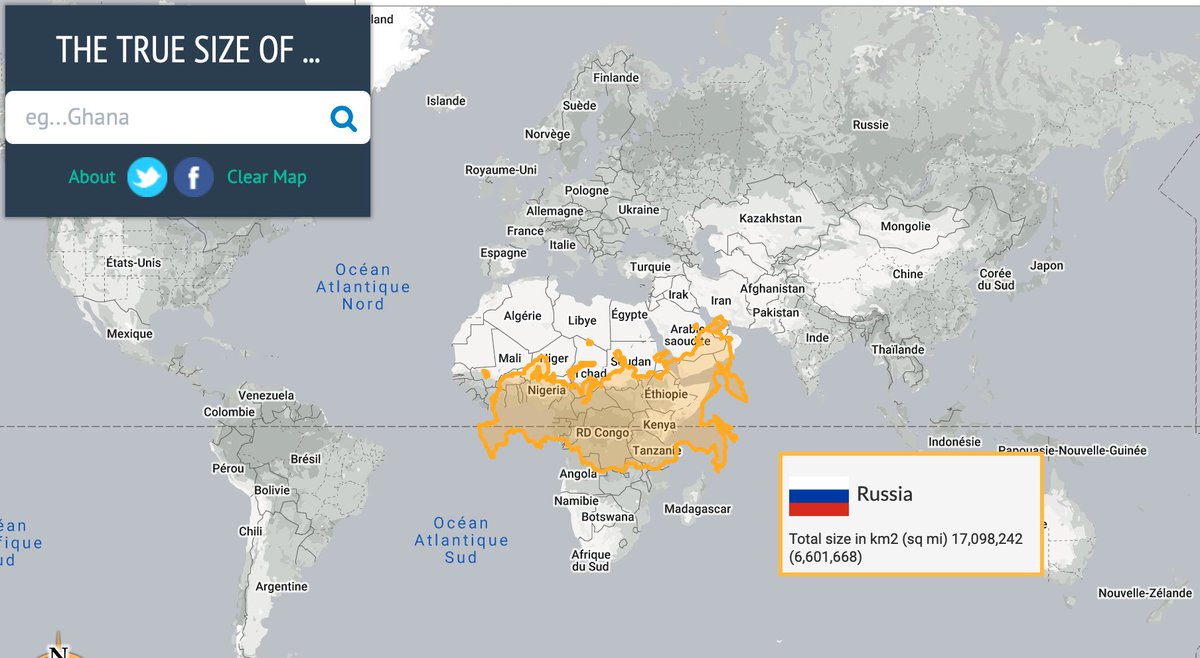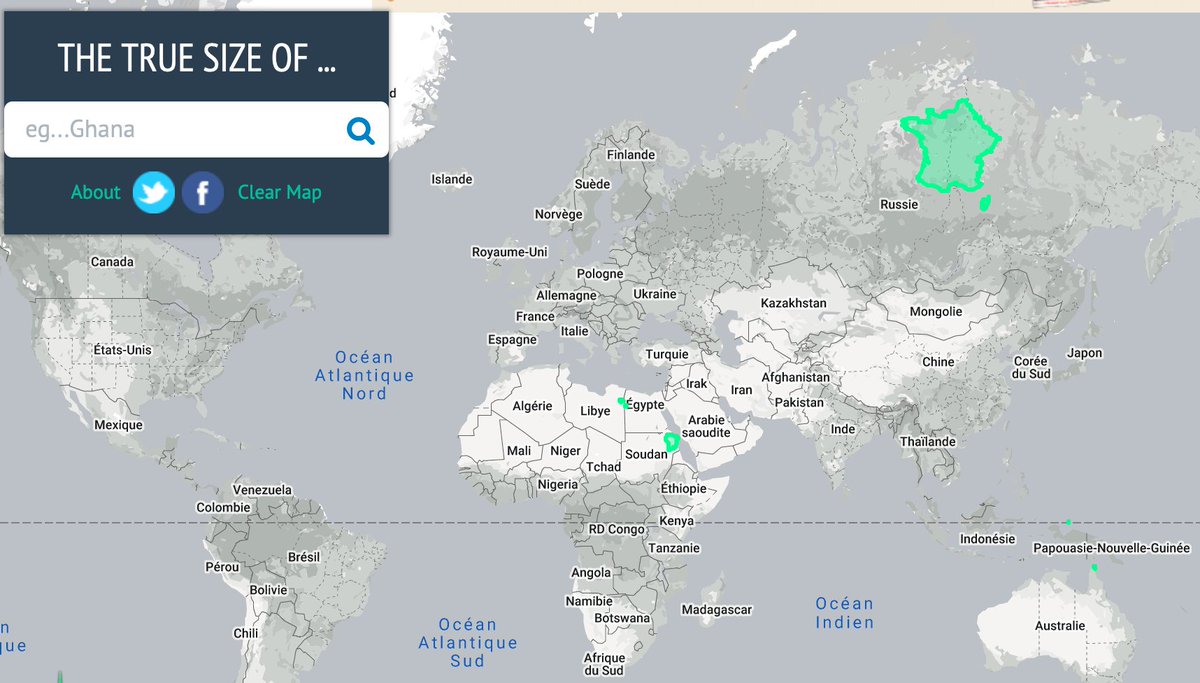Cuisine interne
Les lecteurs avisés de ce compte ont peut-être constaté que je publiais plus sur la Russie et moins sur l'Ukraine ces derniers temps. Je me permets d'en expliquer la raison et de vous faire rentrer dans la cuisine de ma recherche. Petit fil. 🧶1/13
Les lecteurs avisés de ce compte ont peut-être constaté que je publiais plus sur la Russie et moins sur l'Ukraine ces derniers temps. Je me permets d'en expliquer la raison et de vous faire rentrer dans la cuisine de ma recherche. Petit fil. 🧶1/13
Une recherche solide en sociologie politique (mon domaine) doit être fondée sur une enquête de terrain. Or, le terrain physique est en grande partie fermé. Pour rappel, l'université nous interdit les missions en Ukraine. Et la Russie est de moins en moins accessible. 2/13
1ère conséquence: la qualité de notre expertise qui se fonde sur des sources à distance baisse chaque jour. Il faut le dire et le souligner.
Est-ce qu'on ne peut plus rien produire? Bien sûr que si. Ces sources nous sont + lisibles en raison de notre connaissance du terrain. 3/13
Est-ce qu'on ne peut plus rien produire? Bien sûr que si. Ces sources nous sont + lisibles en raison de notre connaissance du terrain. 3/13
Cependant, pour ce qui est de mes terrains de recherche, ma capacité à analyser les évolutions des sociétés russe et ukrainienne n'est pas égale. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi (c'est en soi une hypothèse de recherche). 4/13
Le terrain russe, en dépit des transformations introduites par la guerre, est caractérisé par la CONTINUITÉ des logiques politiques et sociales. Toujours les mêmes acteurs, les mêmes institutions, les mêmes positions sociales, les mêmes procédures, le même quotidien. 5/13
Les concepts que j'utilise semblent rester en grande partie valables et les institutions que j'étudie (comme l'institution militaire ou la protestation citoyenne) se transforment lentement. Je pense donc pouvoir tirer des hypothèses à peu près tenables, pendant qque temps. 6/13
C'est très différent en Ukraine qui est en situation de RUPTURE. La guerre de haute intensité qui se déroule sur son terrain a bouleversé les institutions, les positions sociales et économiques des personnes, le quotidien, les valeurs. Elle a créé de nouveaux clivages. 7/13
Certains espaces sociaux ont été moins affectés que d'autres. Mais tant que je ne suis pas sur le terrain à observer, interroger, analyser, je ne peux rien dire sur les continuités et les ruptures. Ce que je tire des sources à distance a une validité plus limitée. 8/13
Par exemple, il m'est plus difficile d'analyser le déroulement de la mobilisation en Ukraine qu'en Russie. Pour travailler correctement sur l'Ukraine, il faudrait que j'aille voir les centres de recrutement, les autorités militaires, que je discute avec les combattants. 9/13
Le fort engagement patriotique des citoyens ukrainiens est aussi une barrière. Il faut passer ce moment du discours pour arriver à l'évocation des problèmes et difficultés. On sait très bien le faire quand on est sur le terrain. Je dis bien: quand on est sur le terrain. 10/13
En Russie, les infos sont partielles, mais nombreuses et recoupées (elles sont plus rares en Ukraine), et surtout on peut s'appuyer sur ce que l'on sait du fonctionnement de l'administration militaire, ses routines, ses capacités, les acteurs qui y interviennent... 11/13
La résistance passive et active de la société russe à la mobilisation est forte, et génère des sources en provenance d'acteurs très divers. On arrive à recouper, mais tout ça est bien évidemment chronophage: le temps que je passe à faire de la veille est considérable. 12/13
Quand je me permets de partager des hypothèses, il faut qu'elles aient passé mon filtre interne de solidité. J'ai plus d'hypothèses minimalement solides sur la Russie que sur l'Ukraine en ce moment, c'est certain. En attendant le terrain. Clandestin, vous l'aurez compris. 13/13🧶
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh