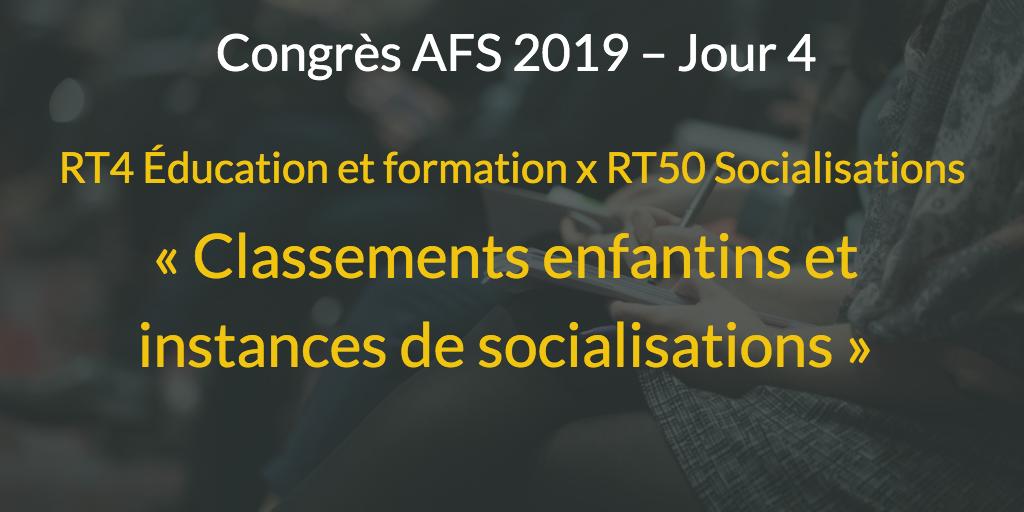#AFS2019 ça continue !
Ici au RT 36 Théories et paradigmes sociologiques, session sur « Le processus de conceptualisation ».
On écoute Rémi Sinthon : « Départager les approches théoriques en fonction de leurs impensés : le cas des conceptions de la stratification sociale »
Ici au RT 36 Théories et paradigmes sociologiques, session sur « Le processus de conceptualisation ».
On écoute Rémi Sinthon : « Départager les approches théoriques en fonction de leurs impensés : le cas des conceptions de la stratification sociale »

Le point de départ du travail de R. Sinthon : vérifier la théorie de la légitimité culturelle.
Son principe : départager les théorisations sociologiques sur le critère de leurs impensés.
Pour commencer, recensement des conceptions de la stratification et de la mobilité sociale.
Son principe : départager les théorisations sociologiques sur le critère de leurs impensés.
Pour commencer, recensement des conceptions de la stratification et de la mobilité sociale.
Pour un autre regard sur cette session, retrouvez aussi le LT de @SocioTonyo.
Une fois le corpus de texte examiné, examen des critiques adressées aux différentes approches et mise en évidence de 6 grands impensés :
1) L'essentialisation des catégories d'analyse
2) L'analyse symétrique de la descente et de l'ascension sociale
1) L'essentialisation des catégories d'analyse
2) L'analyse symétrique de la descente et de l'ascension sociale
3) L'échelle d'analyse, gouvernée par celle des outils empiriques
4) La prétention à un point de vue englobant
5) L'oubli qu'il existe plusieurs dimensions des statuts sociaux
6) Le sujet pertinent de la stratification sociale
4) La prétention à un point de vue englobant
5) L'oubli qu'il existe plusieurs dimensions des statuts sociaux
6) Le sujet pertinent de la stratification sociale
Comment alors éviter ces impensés ? R. Sinthon recommande d'adopter une voie durkheimienne et de penser en termes de faits sociaux.
Pour en savoir plus, je vous renvoie vers l'ouvrage dont est tiré cette comm : _Repenser la mobilité sociale_ (2018)
Pour en savoir plus, je vous renvoie vers l'ouvrage dont est tiré cette comm : _Repenser la mobilité sociale_ (2018)

Question de la salle : que recommande R. Sinthon pour l'innovation théorique en sociologie ?
--> lire autre chose que de la sociologie (ex : de l'histoire des sciences)
--> s'intéresser aux auteurs et promouvoir la cumulativité scientifique (= chercher les 1ers à avoir innové)
--> lire autre chose que de la sociologie (ex : de l'histoire des sciences)
--> s'intéresser aux auteurs et promouvoir la cumulativité scientifique (= chercher les 1ers à avoir innové)
--> construire son terrain empirique sur la base de connaissances théoriques
Recommandation de lecture de la salle :
📖 _Lost in maths. Comment la beauté égare la physique_ de Sabine Hossenfelder
Recommandation de lecture de la salle :
📖 _Lost in maths. Comment la beauté égare la physique_ de Sabine Hossenfelder

Deuxième intervention de cette session :
Julien Larregue et Frédéric Lebaron : « Matérialité de la pensée et résistance à l'idéalisme. Sur l'opportunité d'une interprétation sociologique des processus cérébraux »
Julien Larregue et Frédéric Lebaron : « Matérialité de la pensée et résistance à l'idéalisme. Sur l'opportunité d'une interprétation sociologique des processus cérébraux »
L'enjeu est d'apporter une réflexion autour du concept d’habitus.
F. Lebaron comme par expliquer que les sciences sociales ne se sont pas suffisamment confrontées aux avancées des neurosciences depuis les années 1990.
F. Lebaron comme par expliquer que les sciences sociales ne se sont pas suffisamment confrontées aux avancées des neurosciences depuis les années 1990.
J. Larregue souligne l'enjeu qu'il y a à incorporer les données sur le cerveau dans l'explication sociologique des processus sociaux.
Contre l'idée que la sociologie n'est pas une science cognitive et contre le débat dichotomique « pour/contre » les sciences cognitives.
Contre l'idée que la sociologie n'est pas une science cognitive et contre le débat dichotomique « pour/contre » les sciences cognitives.
--> il y a bien une sociologie cognitive.
La sociologie éclaire bel et bien des processus mentaux (acquisition des connaissances, langage, émotions, mémoire...).
Ex : Durkheim et Mauss ; B. Lahire sur les rêves ; K. Cerulo sur l'odorat (bit.ly/2L6w4ja)...
La sociologie éclaire bel et bien des processus mentaux (acquisition des connaissances, langage, émotions, mémoire...).
Ex : Durkheim et Mauss ; B. Lahire sur les rêves ; K. Cerulo sur l'odorat (bit.ly/2L6w4ja)...
Il s'agit donc de revendiquer l'autonomie scientifique de la sociologie, mais de
remettre en cause son autonomie ontologique : il n'y a pas de processus sociaux qui soient séparés des processus cérébraux, et vice-versa.
📑 Lire à ce sujet A. St-Martin bit.ly/2Uc4hC0
remettre en cause son autonomie ontologique : il n'y a pas de processus sociaux qui soient séparés des processus cérébraux, et vice-versa.
📑 Lire à ce sujet A. St-Martin bit.ly/2Uc4hC0
J. Larregue souligne l'importance de la plasticité cérébrale = le fait que le cerveau est un organe qui évolue au gré des expériences sociales.
--> de là, prolonger l'hypothèse de Bourdieu = le cerveau est aussi un produit du social.
--> de là, prolonger l'hypothèse de Bourdieu = le cerveau est aussi un produit du social.
Dans ce cadre, le concept d'habitus est pertinent pour considérer les données contemporaines sur le cerveau.
En termes neuroscientifiques, l'habitus peut être défini comme une mémoire procédurale découlant d'un apprentissage du cerveau.
En termes neuroscientifiques, l'habitus peut être défini comme une mémoire procédurale découlant d'un apprentissage du cerveau.
F. Lebaron et J. Larregue développent mtn cette approche dans une enquête sur les pianistes de jazz.
Il y a des observations cérébrales de pianistes en train d'improviser, avec des résultats contradictoires : l'activité cognitive est parfois + grande, parfois + basse en impro
Il y a des observations cérébrales de pianistes en train d'improviser, avec des résultats contradictoires : l'activité cognitive est parfois + grande, parfois + basse en impro
Hypothèse des sociologues : les variations de résultats viendraient du fait que certains tests sont faits avec des pianistes classiques, et d'autres avez des pianistes de jazz -->
2 groupes aux socialisations bien différentes qui construisent d'inégaux rapports à l'impro.
2 groupes aux socialisations bien différentes qui construisent d'inégaux rapports à l'impro.
Les intervenants concluent sur la fonction dénaturalisante de la sociologie.
Ils invitent à distinguer naturalisation et biologisation : le biologique n'est pas forcément naturel.
Naturel/biologique/social... autant de catégories encore instables dans leurs travaux.
Ils invitent à distinguer naturalisation et biologisation : le biologique n'est pas forcément naturel.
Naturel/biologique/social... autant de catégories encore instables dans leurs travaux.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh