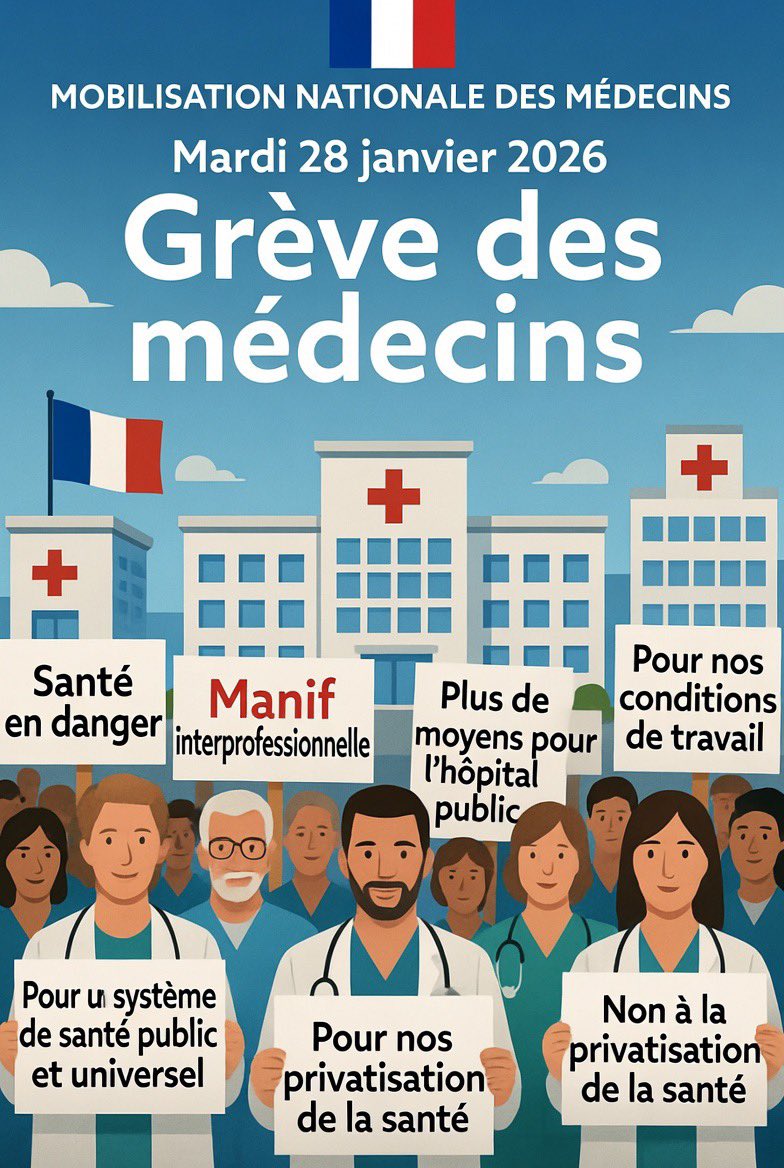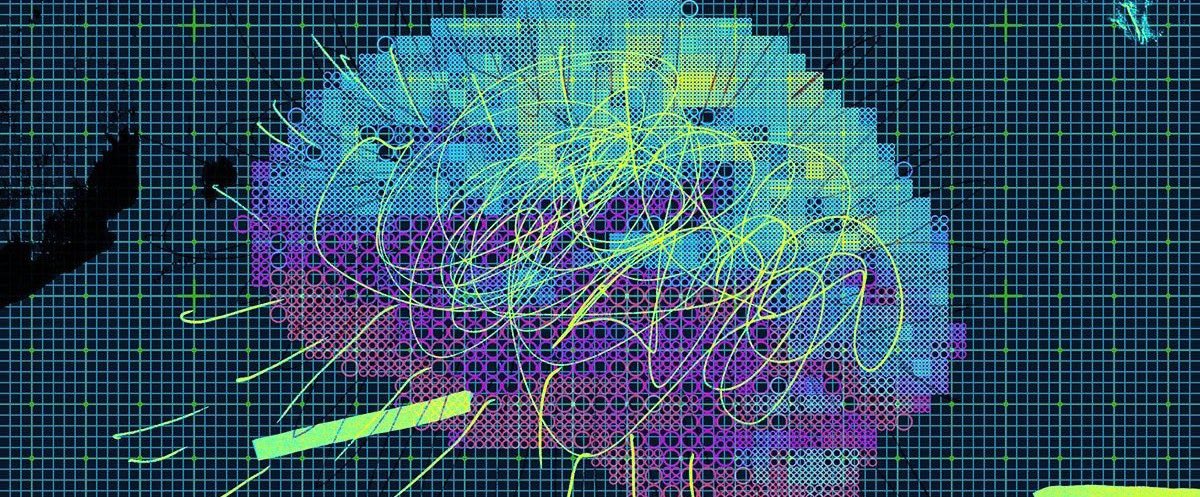Vous faire découvrir les œuvres d’un ami roumain, Virgil Moraru, peintre religieux mais pas seulement, il réalise aussi des vitraux et des mosaïques absolument somptueux !
#Roumanie #Orthodox #Christianity #Artiste #Chrétien



#Roumanie #Orthodox #Christianity #Artiste #Chrétien




Il fait aussi des choses comme ça.. artiste Virgil Moraru, Iasi, #Roumanie 







• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh