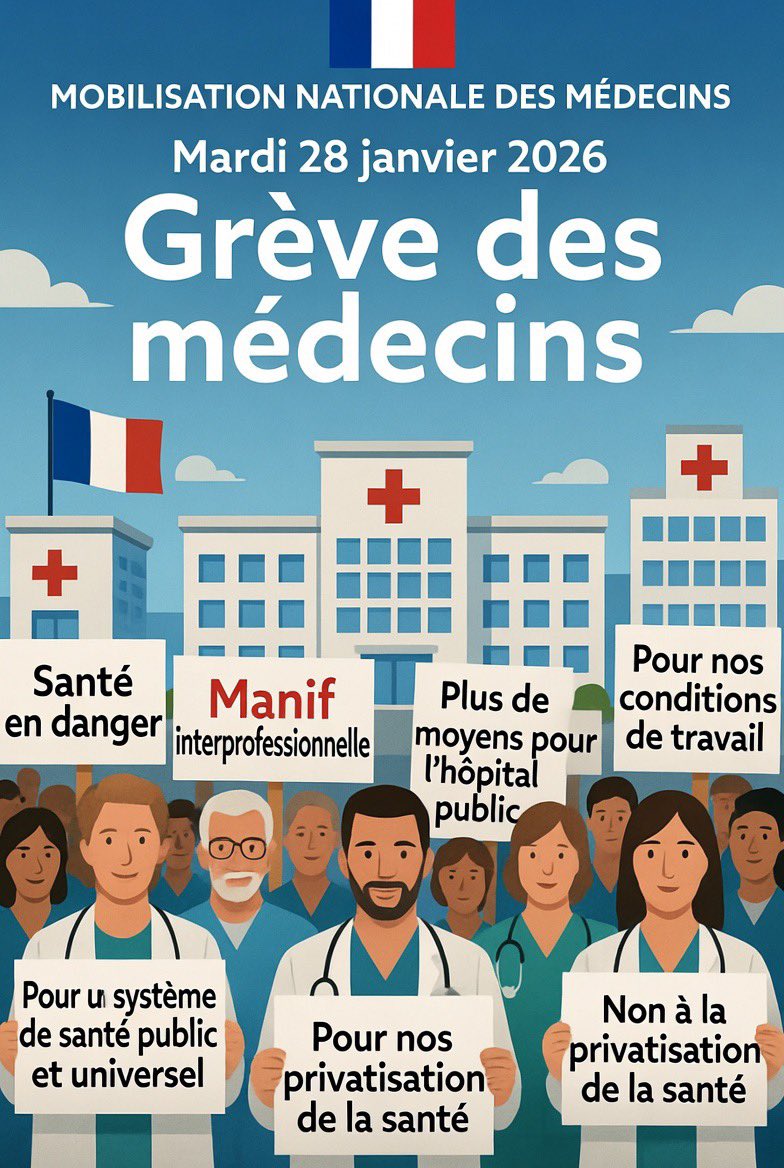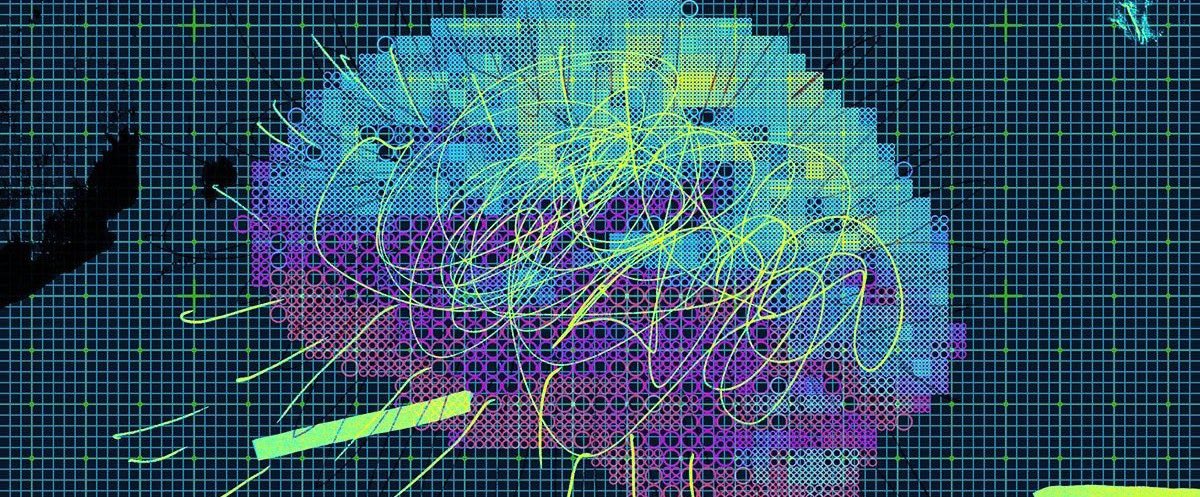La Basilique Cathédrale de Saint-Denis, nécropole des rois de France. Incroyablement émouvant.. terriblement beau.. triste... à chaque fois si bouleversant.. La France ♥️
#France #SaintDenis
« Construite sur la tombe de saint Denis, évêque missionnaire mort vers 250 🔽
#France #SaintDenis
« Construite sur la tombe de saint Denis, évêque missionnaire mort vers 250 🔽

2.
l’abbaye royale de Saint-Denis accueille dès la mort du roi Dagobert en 639 et jusqu’au XIXe siècle, les sépultures de 43 rois, 32 reines et 10 serviteurs de la monarchie. En 1966, la basilique est élevée au rang de cathédrale.
Un musée de sculpture. Avec plus de 70 gisants 🔽
l’abbaye royale de Saint-Denis accueille dès la mort du roi Dagobert en 639 et jusqu’au XIXe siècle, les sépultures de 43 rois, 32 reines et 10 serviteurs de la monarchie. En 1966, la basilique est élevée au rang de cathédrale.
Un musée de sculpture. Avec plus de 70 gisants 🔽
3.
médiévaux et tombeaux monumentaux de la Renaissance, la basilique recèle en son sein, le plus important ensemble de sculpture funéraire du XIIe au XVIe siècle.
La naissance de l'art gothique. Conçue par l'abbé Suger, conseiller des rois, de 1135 à 1144, achevée au XIIIe 🔽
médiévaux et tombeaux monumentaux de la Renaissance, la basilique recèle en son sein, le plus important ensemble de sculpture funéraire du XIIe au XVIe siècle.
La naissance de l'art gothique. Conçue par l'abbé Suger, conseiller des rois, de 1135 à 1144, achevée au XIIIe 🔽

4.
siècle sous le règne de Saint Louis, œuvre majeur de l’art gothique, l’église inaugure la place centrale de la lumière, symbole du divin, dans l'architecture religieuse. » 🔽
siècle sous le règne de Saint Louis, œuvre majeur de l’art gothique, l’église inaugure la place centrale de la lumière, symbole du divin, dans l'architecture religieuse. » 🔽

5.
La chapelle du Saint-Sacrement. 🔽
La chapelle du Saint-Sacrement. 🔽
6.
Louis XVII, 1785 + 1795, Louis Charles de France, second fils de #LouisXVI et de #MarieAntoinette, reconnu roi de #France en 1793. Cour déposé en 1975 à Saint-Denis, puis, après authentification. installation dans la chapelle des Bourbons le 8 juin 2004. 🔽

Louis XVII, 1785 + 1795, Louis Charles de France, second fils de #LouisXVI et de #MarieAntoinette, reconnu roi de #France en 1793. Cour déposé en 1975 à Saint-Denis, puis, après authentification. installation dans la chapelle des Bourbons le 8 juin 2004. 🔽


8.
Charles Martel, Clovis II, Isabelle d’Aragon, Philippe IV le Bel, Philippe III, le Hardi.. Henri II et Catherine de Medicis, Marie de Bourbon Vendôme. 🔽

Charles Martel, Clovis II, Isabelle d’Aragon, Philippe IV le Bel, Philippe III, le Hardi.. Henri II et Catherine de Medicis, Marie de Bourbon Vendôme. 🔽


9.
La chapelle des Bourbons
Dans la première moitié du XIXe siècle, l'architecte
Francois Debret (1777-1850)
place dans la crypte, en ordre chronologique, tous les gisants de Saint-Denis. Pour les rois sans tombeaux sculptés, il commande une série d'inscrip tions funéraires et 🔽
La chapelle des Bourbons
Dans la première moitié du XIXe siècle, l'architecte
Francois Debret (1777-1850)
place dans la crypte, en ordre chronologique, tous les gisants de Saint-Denis. Pour les rois sans tombeaux sculptés, il commande une série d'inscrip tions funéraires et 🔽

10.
de tombeaux factices dont une partie est présentée ici. Pour les réaliser, Debret utilise de nombreux fragments lapidaires des XVII et XVIIIe siècles apportés par Alexandre Lenoir en 1818. 🔽
de tombeaux factices dont une partie est présentée ici. Pour les réaliser, Debret utilise de nombreux fragments lapidaires des XVII et XVIIIe siècles apportés par Alexandre Lenoir en 1818. 🔽

16.
♥️
♥️
17.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh