La semaine dernière, j’évoquais le concept de honte prométhéenne, que Günther Anders définit comme le sentiment d’infériorité que l’humain peut ressentir «devant l’humiliante qualité des choses qu’il a lui-même fabriquées.» Je voudrais apporter des précisions importantes. 1/25
https://twitter.com/BounouaSamy/status/1706049612161650819
En effet, certain.e.s de mes lecteurs et lectrices ont fait part de leurs doutes sur la validité de ce concept. Au fond, une telle honte est-elle vraiment justifiée ? Ne serait-ce pas notre imagination qui nous joue des tours ? C’est la première objection qui m’a été faite. 2/25
Pour répondre à ces interrogations, il faut revenir plus précisément sur ce que Günther Anders entend par «honte». D’après lui, ce sentiment provient d’un trouble de l’identification : nous sommes honteux lorsque le rapport réflexif que nous avons avec nous-même échoue. 3/25 

Autrement dit, la honte résulte de ce constat : «c’est bien moi, mais ce n’est pourtant pas moi.»
Le «moi» est l’individu libre (ou qui se croit tel), indépendant, conscient de lui-même, agissant conformément à ce qu’il est et ce en quoi il croit. 4/25
Le «moi» est l’individu libre (ou qui se croit tel), indépendant, conscient de lui-même, agissant conformément à ce qu’il est et ce en quoi il croit. 4/25
Cependant, «arrive toujours le moment où il se heurte aux limites de sa liberté, de son individualité, de sa conscience de soi […]» ; le moment où il se rend compte de toutes les déterminations qui l’aliènent, perturbant sa plénitude. 5/25
Ces déterminations, Anders les appelle le «ça», en clin d’œil à Freud, mais dans sa pensée, le «ça» ne désigne pas seulement les pulsions qui résident dans l’inconscient : il s’agit de tout ce qui est «pré-individuel» (le corps, les gènes, la finitude, la société, etc.) 6/25
Le «ça» andersien est en fait indissociable du moi : c’est un «legs ontique» (un legs relatif à ce qu’on est). «La honte naît à l’instant de la découverte de ce legs», écrit Anders. En effet, une telle découverte se produit quand le «ça» est difficile à assumer. 7/25
Ainsi, le bossu est honteux de sa bosse quand il découvre que cette excroissance est une tare ; l’ascète est honteux quand il découvre qu’il a des envies et pulsions hédonistes. Certes, ils n’y peuvent rien, mais cette impuissance renforce la honte plus qu’elle ne l’excuse. 8/25
«La honte éclate parce qu’on est à la fois "soi-même" et un autre.» Cela vaut également pour celui qui commet une mauvaise action : il a honte car il est identifié à une personne qu’il ne veut pas être. Lui aussi découvre le «ça», sous la forme des normes sociales. 9/25
Ces définitions étant posées, qu’en est-il de la honte prométhéenne ? Elle émerge quand le moi est écrasé par un «ça» d’un nouveau genre : le «ça mécanique». Dans notre monde de machines, le «moi» tend à devenir un simple rouage, et donc à disparaître en tant que «moi». 10/25
L’individu aliéné souhaite devenir un rouage, mais il réalise bien vite que la chose est impossible : la machine, infatigable, finit toujours par le dépasser. Les travailleurs «chaplinesques», dont les mouvements sont parfaitement machinaux, n’existent pas. 11/25
Dans cette situation, le «moi» ne parvient pas à s’identifier au «ça mécanique». Par cet échec, il se découvre lui-même : être organique et faillible. Il se découvre comme n’étant pas à la hauteur de la machine, qui fixe les critères d’évaluation. 12/25
C’est alors que la honte se fait sentir : la honte de ne pas être adapté, d’être obsolète. Ce sentiment n’est donc pas une invention de philosophe. Il est éprouvé tous les jours, quotidiennement, par les travailleurs qui ont le défaut de ne pas être de bons rouages. 13/25
À l’heure de l’explosion de l’intelligence artificielle, ce qui est vrai des travailleurs de la grande usine le devient aussi pour les intellectuels. Garry Kasparov pensait que jamais un ordinateur ne pourrait le vaincre aux échecs : en 1997, DeepBlue lui a donné tort. 14/25 

Plus récemment, en 2016, le maître du jeu de go Lee Sedol a lui aussi été humilié par une machine : AlphaGo. «J’ai tellement honte en tant que professionnel», «je ne veux plus participer à une rencontre de ce type» : voilà ce qu’a déclaré Lee Sedol à la presse. 15/25 

Aujourd’hui, l’émergence des modèles de langage (ChatGPT, etc.) ou des générateurs d’images (MidJourney...), nous met chaque jour un peu plus dans la situation de ces champions déchus : notre «moi» découvre le «ça mécanique» et, partant, se découvre lui-même comme obsolète. 16/25
Il reste un paradoxe à résoudre dans le concept de honte prométhéenne : alors que celle-ci s’éprouve face à des machines, la honte implique une «instance» dont on craint le regard. Or, les machines ne voient rien et ne sont en aucun cas susceptibles de nous juger. 17/25
Mais pour Anders, «l’attitude naturelle» consiste précisément à considérer que le monde nous regarde, bien qu’il soit effectivement aveugle. Pourquoi, avant d’adopter un comportement inadéquat, seul dans notre appartement, nous avons des scrupules à nous désinhiber ? 18/25
Pourquoi Robinson Crusoé ne restait-il pas nu sur son île ? Pourquoi, encore, le poète affirme-t-il très sérieusement que la montagne nous regarde d’un air menaçant ? Parce que dans «l’attitude naturelle», «pré-théorique», le monde est bel et bien une instance. 19/25 

Le concept de honte prométhéenne se justifie donc pleinement : c’est une honte à part entière, et non une simple «métaphore». Mais alors, si pour surmonter ce sentiment douloureux, nous devons faire le choix de «l’ingénierie humaine», où est le mal ? 20/25
https://x.com/BounouaSamy/status/1706049674891698359
Après tout, n’est-ce pas le propre de l’humain que d’évoluer et de s’adapter ? C’est la seconde objection sérieuse de mes contradicteurs/trices. Là encore, Anders n’élude pas la question. Il ne donne pas de valeur particulière à l’espèce humaine telle qu’elle est. 21/25 
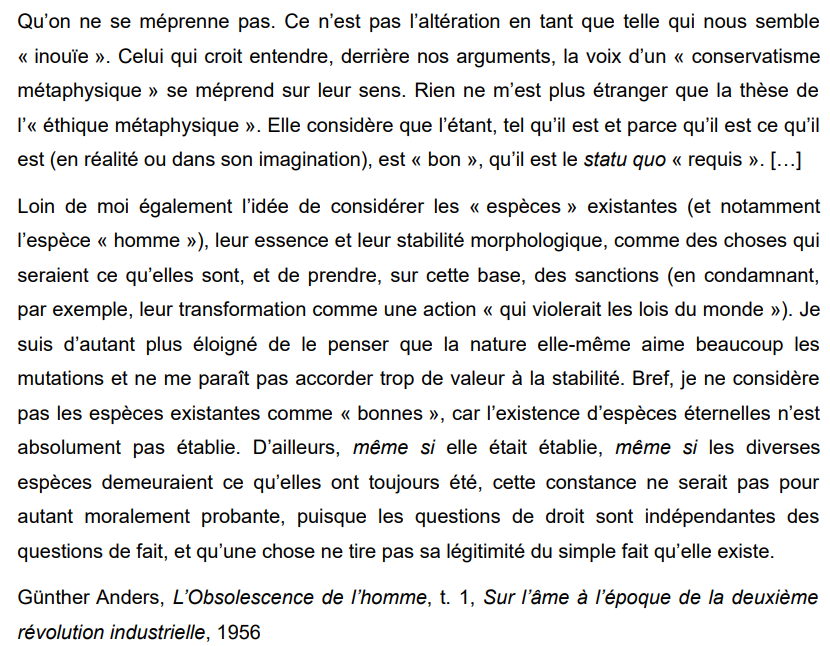
S’il rejette l’ingénierie humaine, c’est parce que cette évolution suit le modèle des instruments : s’instrumentalisant lui-même, l’humain abandonne toute autonomie. Par ailleurs, il ne pourra jamais suivre le rythme du «ça mécanique», qui finira par le rendre honteux. 22/25 
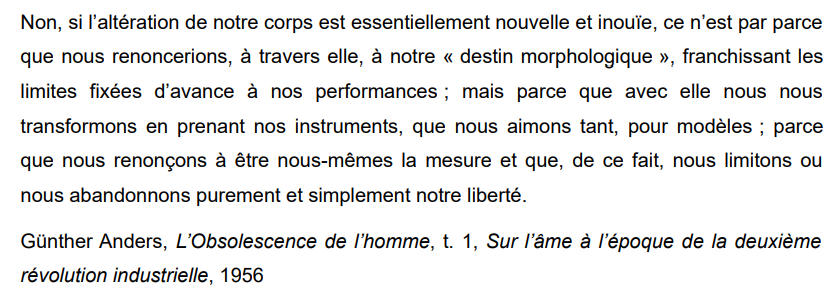
Le transhumanisme, forme contemporaine de l’ingénierie humaine, apparaît dès lors comme l’aliénation ultime : pour ne pas être dépassé par l’intelligence artificielle, derrière laquelle il faut «galoper» toujours plus vite, il est indispensable de nous machiniser nous-même. 23/25
Le choix ne nous est pas donné : nous somme contraints de devenir des «cyborgs», c’est-à-dire des êtres adaptés à la survie dans un endroit littéralement inhabitable (rappelons que le terme de cyborg a été inventé pour penser le voyage spatial à long terme…) 24/25
Il y aurait beaucoup d’autres choses à dire sur le transhumanisme (qui n’a rien à voir, comme on a pu me le dire très naïvement, avec le port de lunettes ou de chaussures), mais ce thread est déjà assez dense. Ce sera pour une prochaine fois. 25/25
@DjmbLe @spinoza2021 @Bourguiguignon
(@JZefka aime un thread avec de l'écriture inclusive, je crois que c'est assez rare pour être noté 😊)
unroll @threadreaderapp
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh











