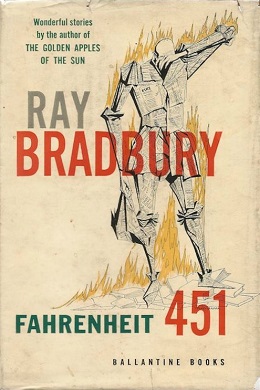C'est joli, mais c'est tellement faux. 1) Il n'y a pas "une" éloquence, il y a différentes formes d'éloquence qui ne sont pas toutes jugées légitimes de la même manière 2) l'éloquence (légitime) est une compétence qui n'est pas innée, mais acquise. 

Ce qui m'intéresse, c'est qu'en plus il lie ça aux transfuges de classe : "J'ai toujours été fasciné par les transfuges de classe et le meilleur instrument de l'égalité selon moi reste l'éloquence. C'est une des seules choses que l'on peut trouver dans tous les milieux sociaux"
J'aimerais bien savoir un peu plus ce qu'il entend par là. Que l'éloquence permet une forte mobilité de classe? C'est vraiment une vision très idéaliste de la mobilité de classe (mais ça va avec une certaine mythification très anti-socio mais très romanesque des transfuges)
C'est complètement faux de penser qu'une manière de parler peut transcender les espaces. Bourdieu parlait de "marché linguistique": c'est l'idée qu'un parler peut se trouver apprécié, jugé, rejeté ou accepté, selon les règles du « marché » lié à une situation.
On peut être (et être jugé) très éloquent dans certains contextes (marchés linguistiques) et pas dans d'autres. Sauf que certains marchés vont être jugés plus légitimes que d'autres (typiquement les marchés institutionnels, l'école, la justice, etc...)
Bien sûr que tout n'est pas figé et qu'on peut avoir une éloquence reconnue, même dans les marchés légitimes, quand on vient de milieu populaire, et venir d'un milieu privilégié et souffrir au contraire d'insécurité linguistique (d'une peur de parler, de faire des fautes)
Mais si on a baigné dans un milieu dans lequel le langage était proche de celui de l’école, de la culture dite légitime, si on a eu une éducation qui a guidé et valorisé notre parole, eh bien on a plus de chance de maitriser l'éloquence légitime. Ce n'est pas un don abstrait.
Par ailleurs,si on a bénéficié de tout ça,on sera à l'aise non seulement pour maîtriser les codes dominants mais aussi pour naviguer entre les différents registres, on sait s’adapter. Si ce n’est pas, dès qu’on doit sortir de nos habitudes, on ressent de l'insécurité linguistique
Les personnes vraiment dominantes linguistiquement ne sont pas celles qui vont avoir tout le temps une éloquence cicéronienne ou parler tout le temps de manière extrêmement soutenue (d'ailleurs, personne ne fait ça...)
Mais plutôt celles qui vont naviguer entre différents registres, qui vont savoir spontanément (mais c'est une spontanéité acquise...) adapter leur langage à la situation, au contexte, aux interlocuteurs/rices, etc...
Bref, "bien" parler 1) ce n'est pas une seule manière de parler, il n'y a pas "une" éloquence, c'est une capacité d'adaptation aux contextes 2) ça S'APPREND. Que ce soit par son éducation, par l'école, par d'autres pratiques
ça s'apprend sur le long terme, par la pratique (pas par dix trucs et astuces rhétoriques) notamment par la pratique collective (les assocs, les collectifs, qu'il s'agisse de théâtre, de lutte féministe, de devenir porte-parole de l'association de bingo du coin, etc).
Donc "l'éloquence" n'est pas un don qu'on peut "trouver" tel quel dans tous les milieux sociaux - et je n'ai même pas parlé de la question d'accès matériel à la parole publique..
Une belle éloquence dans le square du coin ne mène pas très loin... qui possède les moyens de diffusion de cette parole? qui y a accès? Bref, je suis pour les formations à la prise de parole, mais pas de manière idéaliste/romanesque
Et encore une fois je trouve ça significatif qu'il lie ça aux récits de transfuge qui oui, sont fascinants mais 1) très minoritaires sociologiquement 2) souvent racontés de manière plus romanesque que sociologique avec une forte auto-héroïsation (même si on cite Bourdieu)
C'est tout à fait compréhensible de penser/d'espérer que l'éloquence et tout ce qui y est attaché (l'art, la littérature) puisse permettre d'établir des liens entre milieux sociaux, d'aider à développer des passerelles... quand on est prof, bien sûr qu'on travaille pour ça.
Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas l'aborder de manière idéaliste comme un remède un peu magique. Sinon on s'expose à des déceptions (ou des films gênants sur un prof d'éloquence/d'opéra qui va sauver un jeune de banlieue urbaine en lui révélant son don caché)
On aime bien d'ailleurs ces images d'individus "sauveurs" (ça va avec nos envies de romanesque, la rencontre qui change la vie), mais comme l'a montré le sociologique Paul Pasquali, ces "passeurs" pour fonctionner, doivent être pluriels...
Ce n'est pas UN prof mais la conjugaison de telle association du coin, telle option théâtre, telle bibliothèque publique qui se bat pour rester ouverte, etc, etc.
Allez je me tais. Sur l'insécurité linguistique et les moyens d'(essayer) de la combattre, j'avais fait cette chronique.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh