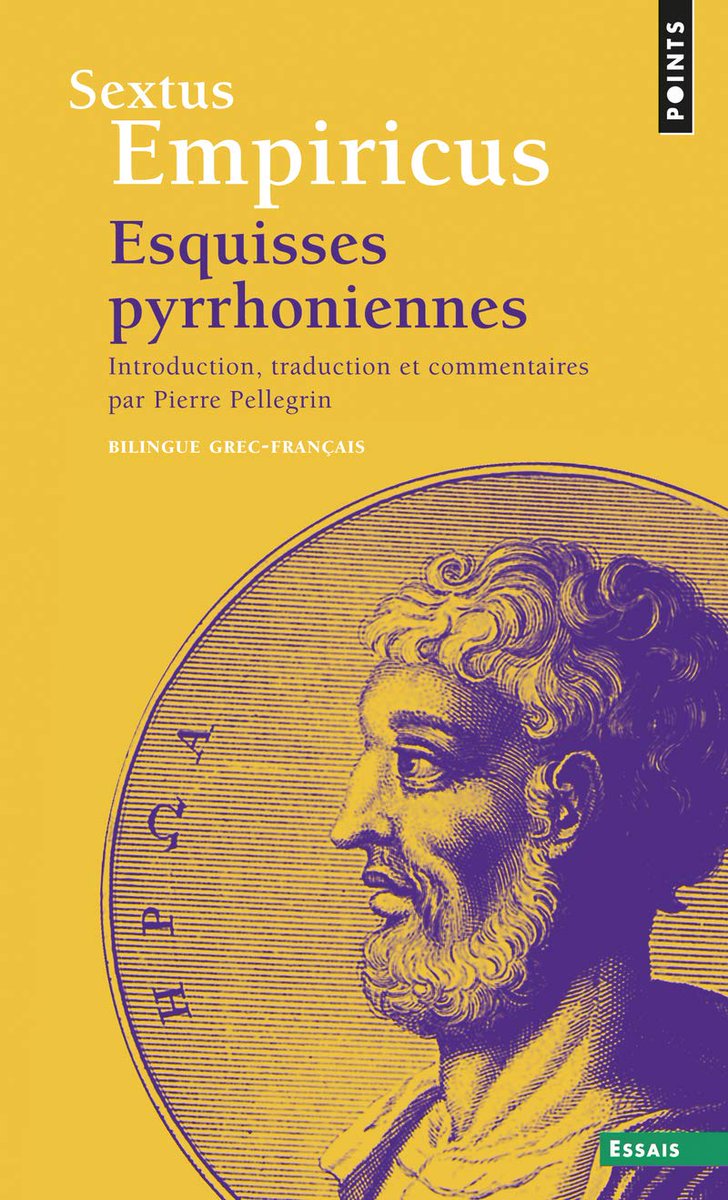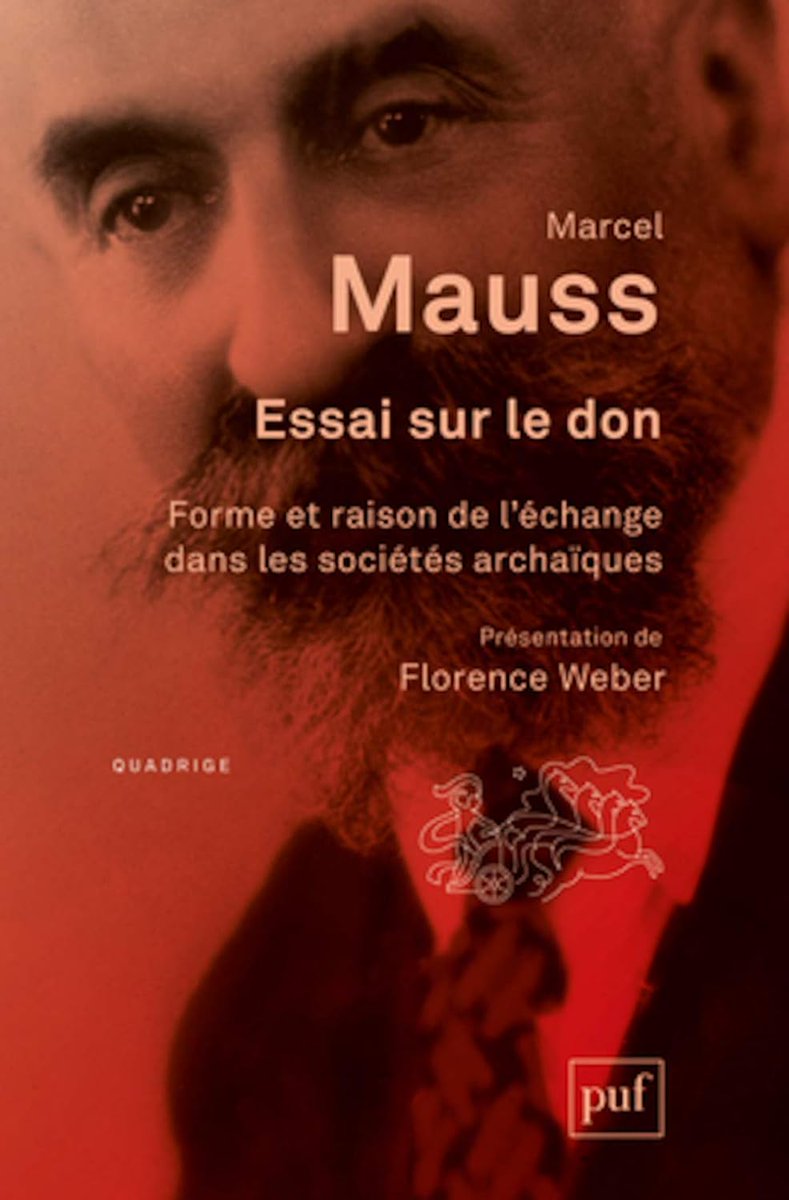Aujourd’hui, je vous propose une présentation de la “Métaphysique des mœurs” de Kant.
Dans cet ouvrage majeur, il développe les différents principes du juste et de l’éthique auquel on aboutit en appliquant ce qu'il appelle la "loi fondamentale" de la raison.
Allons-y !
1/25
Dans cet ouvrage majeur, il développe les différents principes du juste et de l’éthique auquel on aboutit en appliquant ce qu'il appelle la "loi fondamentale" de la raison.
Allons-y !
1/25

La "loi fondamentale" de la raison dont parle Kant peut être vue comme une formulation un peu plus précise de principes que l’on utilise souvent dans la vie courante ; par exemple on dit « si tout le monde faisait comme toi… » (on ne finit pas la phrase généralement)
2/25
2/25
Ou encore : « est-ce que ça te plairait que tout le monde fasse la même chose que toi ? ». Et, en effet, au nom de quoi aurions-nous le droit de faire une exception pour nous-même ? Je ne vais pas ici m’étendre sur cette loi fondamentale en elle-même,
3/25
3/25
je mentionne simplement sa formulation par Kant : "Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté [=la règle que tu suis dans ton action] puisse toujours valoir en même temps comme principe d'une législation universelle". (cf. les liens à la fin de ce fil pour approfondir)
4/25
4/25
Pour appliquer la loi fondamentale de façon systématique, Kant soutient qu’il faut d’abord faire une grande distinction entre deux types d’application : d’un côté l’application qui peut aboutir à des lois "extérieures", et de l’autre celle qui reste "intérieure".
5/25
5/25
Autrement dit, d’un côté il y a le domaine "juste" ou du "droit" (Recht) ; les principes du juste qui le constituent seront à la base des bons systèmes juridiques, ils peuvent être appliqués au sein du droit des juristes, le droit "positif", promulgué, en vigueur.
6/25
6/25
De l’autre côté, il y a le domaine de "l’éthique", ou encore de la "vertu", c’est-à-dire des principes qui n’ont pas vocation à devenir des lois extérieures, à être promulgués, et assortis de sanctions juridiques, ou de contraintes extérieures de manière générale (police, etc.)
7
7
« Tous les devoirs sont ou bien des devoirs de droit, c’est-à-dire des devoirs pour lesquels est possible une législation extérieure, ou bien des devoirs de vertu [ou devoirs éthiques] pour lesquels une telle législation n’est pas possible » (Ak. VI, 239 ; trad. GF p. 28).
8/25
8/25
Commençons par le 1er domaine, celui du "juste", du "droit" philosophique. Le test d’universalisation, sous cette première forme, implique au minimum de s’abstenir de faire ce qui rend la coexistence impossible. Mais derrière cette formule simple se cachent des difficultés.
9/25
9/25
La coexistence pacifique est en effet possible de bien des manières, y compris en interdisant quasiment toutes les actions. Rousseau a d’ailleurs écrit à ce sujet « on vit tranquille aussi dans les cachots ». Mais on ne veut pas vivre de cette manière.
10/25
10/25
Ainsi, contrairement à ce que supposait Hobbes, le principe de la coexistence pacifique n’est pas suffisant pour déterminer le juste et l’injuste.
On pourrait dès lors se tourner vers l’idée du bonheur général, de l'intérêt commun (car le bonheur passe pour le but ultime).
11/25
On pourrait dès lors se tourner vers l’idée du bonheur général, de l'intérêt commun (car le bonheur passe pour le but ultime).
11/25
Le principe du juste serait alors le suivant : sont justes les règles nécessaires à la coexistence la plus heureuse possible. Mais on ne peut pas vraiment construire sur cette base, car on ne sait pas vraiment ce qui va augmenter la somme totale de bonheur.
12/25
12/25
Le principe du juste, chez Kant, est dès lors plus précisément un principe relatif à la coexistence des libertés.
"Toute action est juste qui peut faire coexister la liberté de la volonté de chacun avec la liberté de tout autre, selon une loi universelle".
13/25
"Toute action est juste qui peut faire coexister la liberté de la volonté de chacun avec la liberté de tout autre, selon une loi universelle".
13/25
Au XXème siècle, Rawls donnera une forme plus précise à ce principe : « chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de libertés de base, égales pour tous, qui soit compatible avec le même système pour les autres. » (Théorie de la justice)
14/25
14/25

Chez Kant, la théorie du juste se décline en diverses règles relatives au droit privé (propriété privée, respect des contrats, …) et au droit public (sur la façon d’organiser l’Etat, et les rapports entre différents Etats en vue de la paix).
On en restera là pour le juste.
15/25
On en restera là pour le juste.
15/25
Venons-en maintenant au second domaine, celui de l’éthique, relatif aux devoirs qui ne peuvent pas devenir des obligations extérieures. Il s’agit en fait surtout de se proposer certains buts éthiques (or aucune loi extérieure ne peut vérifier quels sont mes buts).
16/25
16/25
Ces buts "ne peuvent être soumis à aucune législation extérieure pour cette simple raison qu’ils portent sur une fin qui est en même temps un devoir ; que l’on se propose une fin, cela ne peut être le produit d’aucune législation extérieure (c’est un acte intérieur de l’esprit)."
Au sein de ce domaine éthique, Kant fait la distinction entre des devoirs envers autrui (bienfaisance, aide, etc.) et des devoirs envers soi-même (il parle alors du devoir de "perfectionner nos facultés", à la fois nos facultés physiques et nos facultés intellectuelles).
18/25
18/25
L’idée suivant laquelle nous aurions des devoirs envers nous-mêmes est assez souvent critiquée. Il semble plus simple de penser que nous n’avons que des devoirs envers les autres. Mais à vrai dire cette position plus simple n’est pas nécessairement la meilleure.
19/25
19/25
Kant soutient que l’on ne peut pas véritablement vouloir d’un monde dans lequel la fainéantise, le laisser-aller, etc. seraient des normes. Autrement dit, le principe nous autorisant à négliger le développement de nos facultés naturelles n’est pas vraiment universalisable.
20/25
20/25
Pour ce qui concerne enfin les devoirs éthiques envers les autres, ils sont déduits là encore du test d’universalisation. Par exemple, le devoir d’aider quelqu’un en danger provient du fait que chacun voudrait être aidé s’il était dans la même situation (cf. texte ci-joint)
21/25


21/25


Kant soutient que « les devoirs éthiques sont d’obligation large, alors que les devoirs de droit sont d’obligation stricte. »
Les devoirs éthiques sont d’obligation « large », c’est-à-dire que l’on ne sait pas exactement à quel point il faut les appliquer.
22/25
Les devoirs éthiques sont d’obligation « large », c’est-à-dire que l’on ne sait pas exactement à quel point il faut les appliquer.
22/25
Autrement dit, il y a une « latitude », un « espace de jeu », il n’est pas précisément obligatoire d’être bienfaisant à tel ou tel niveau, de travailler à perfectionner ses facultés de telle ou telle manière, etc. Car les devoirs éthiques se limitent entre eux.
23/25
23/25
Cela vaut aussi pour l’impératif de la sincérité (ce point est très peu connu d'ailleurs). Kant se demande par exemple ce qu'il faut faire si un auteur nous demande « comment trouvez-vous mon œuvre ? ». Admettons que je suis une des seules personnes qui a lu son roman,
24/25
24/25
et que je l’ai détesté. Faut-il lui dire ? "La moindre hésitation mise à répondre est déjà humiliante pour l’auteur : est-il donc permis de lui parler en toute sincérité ?". Les questions de ce genre sont "casuistiques", et malheureusement la philosophie ne peut y répondre.
25/25
25/25
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh