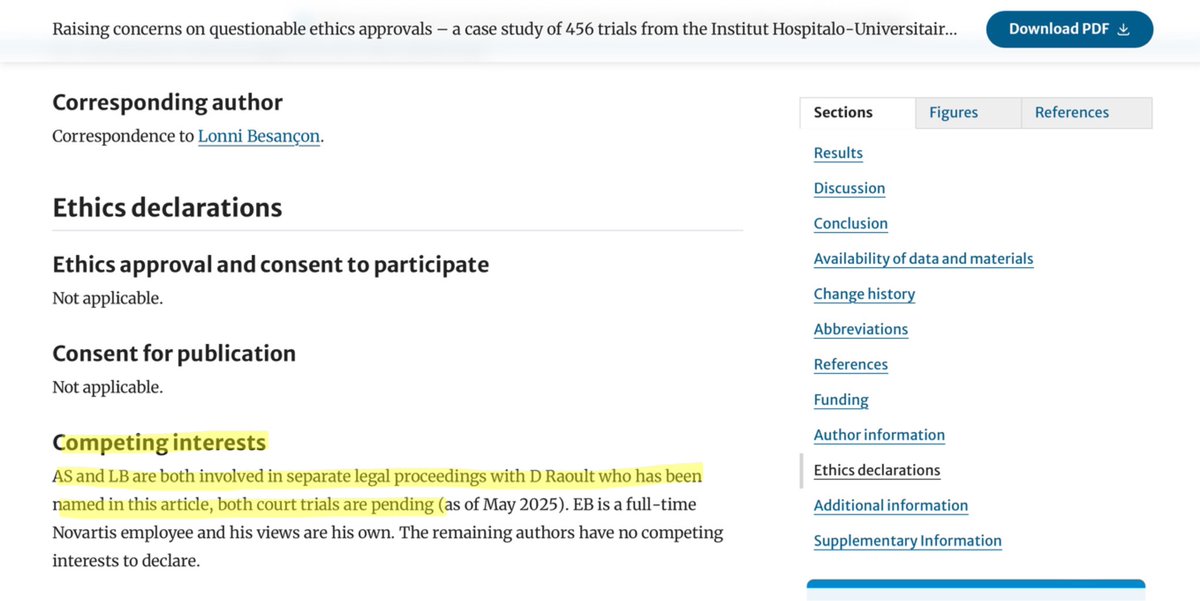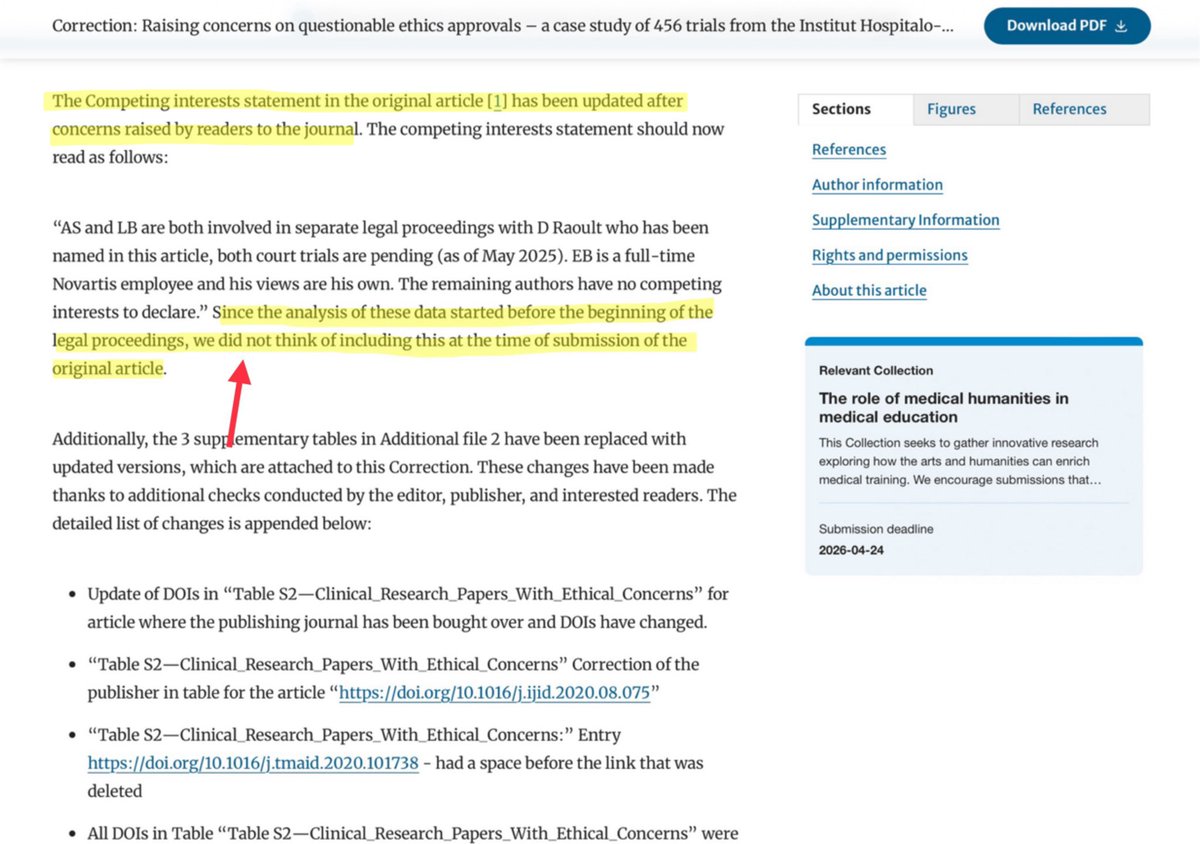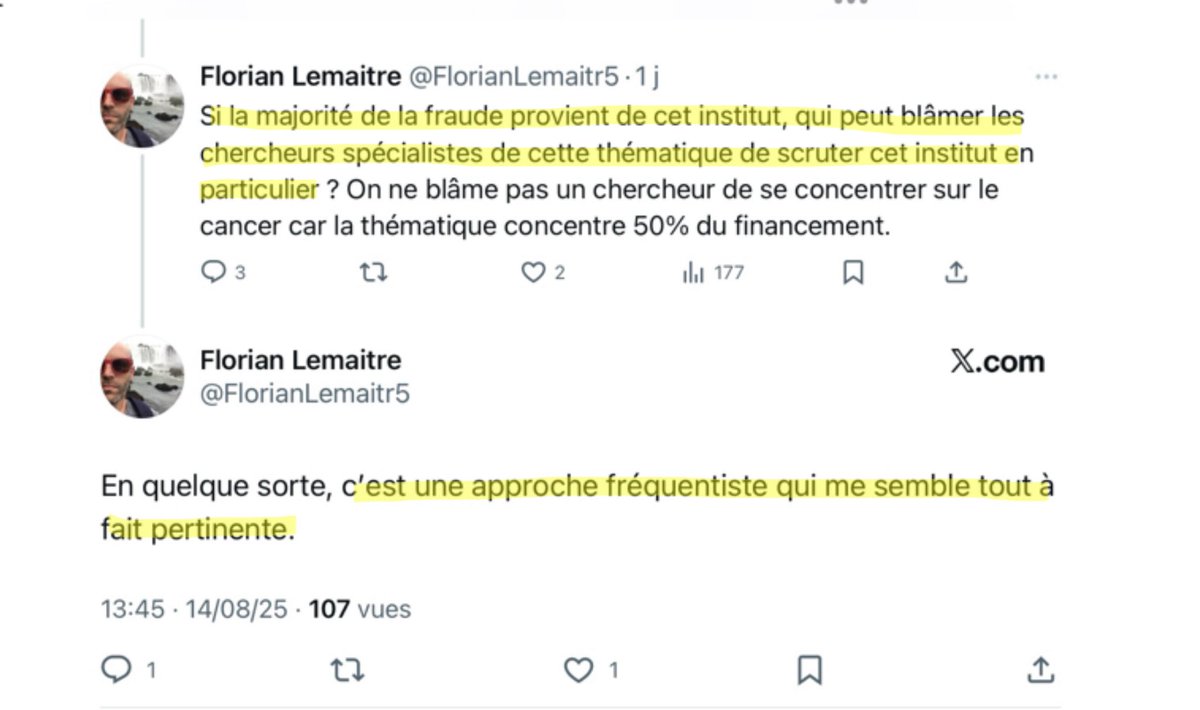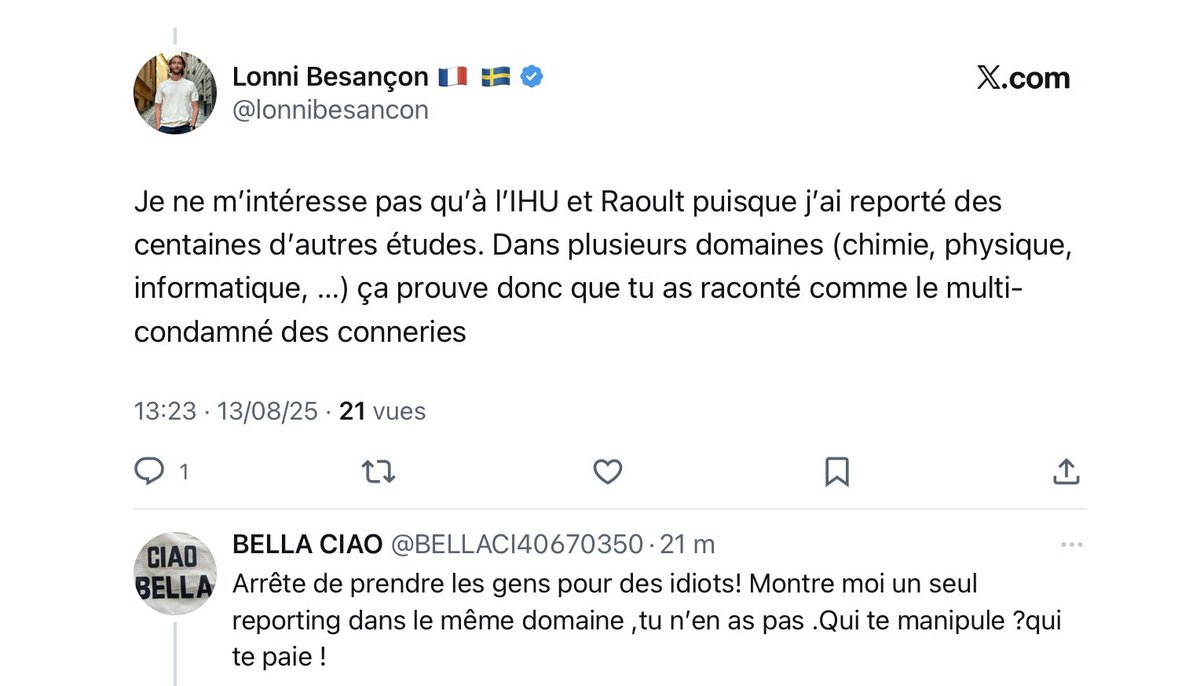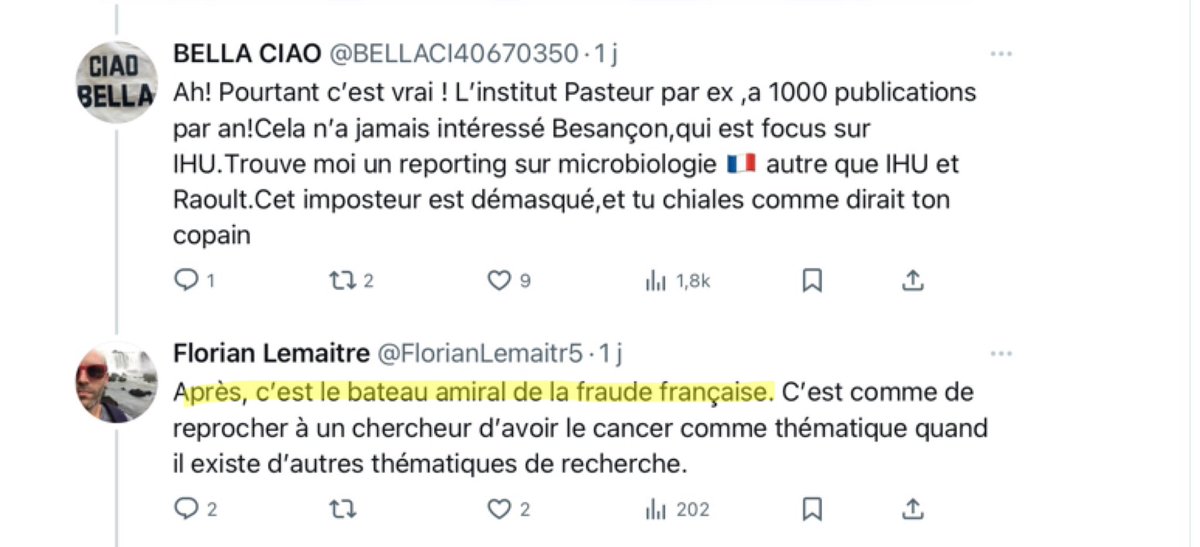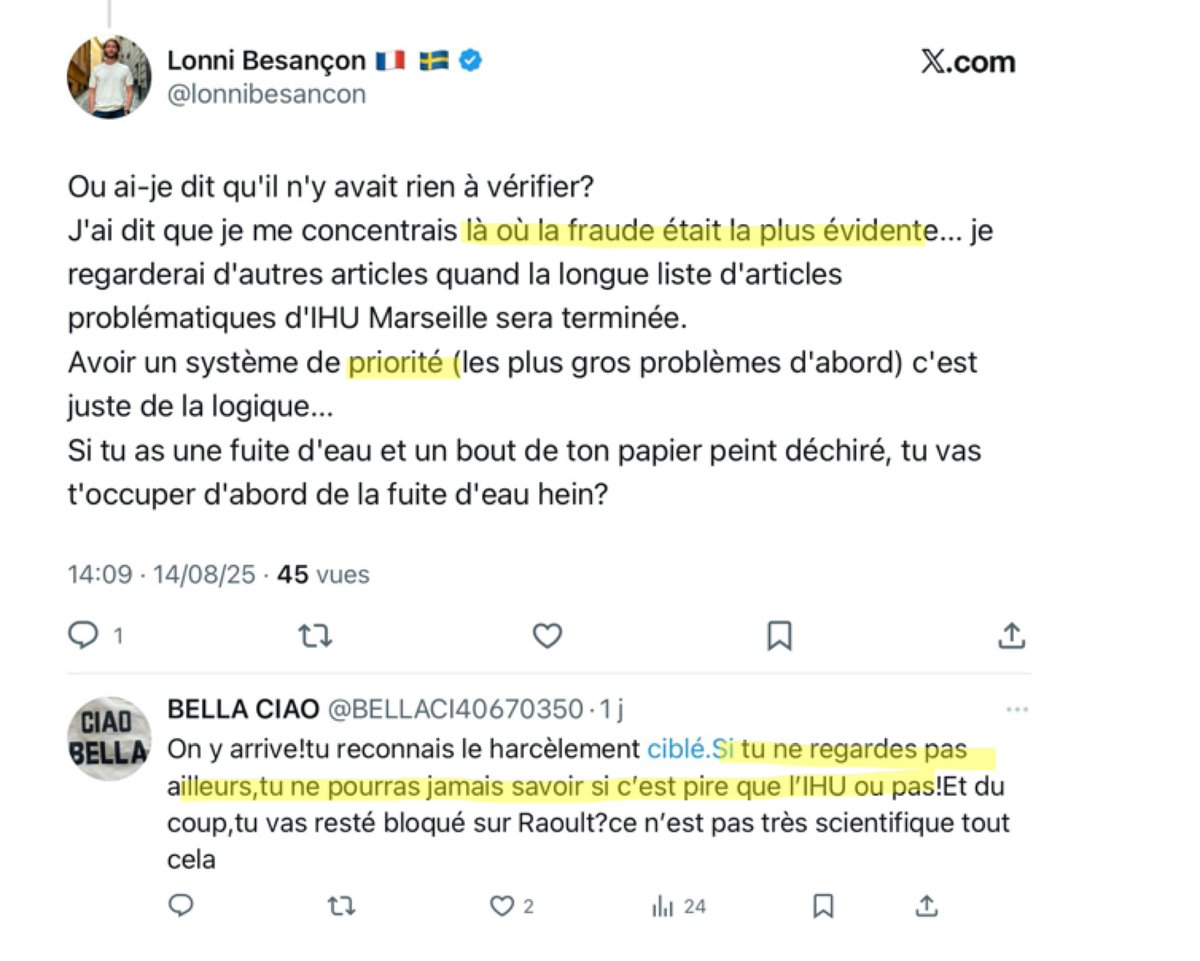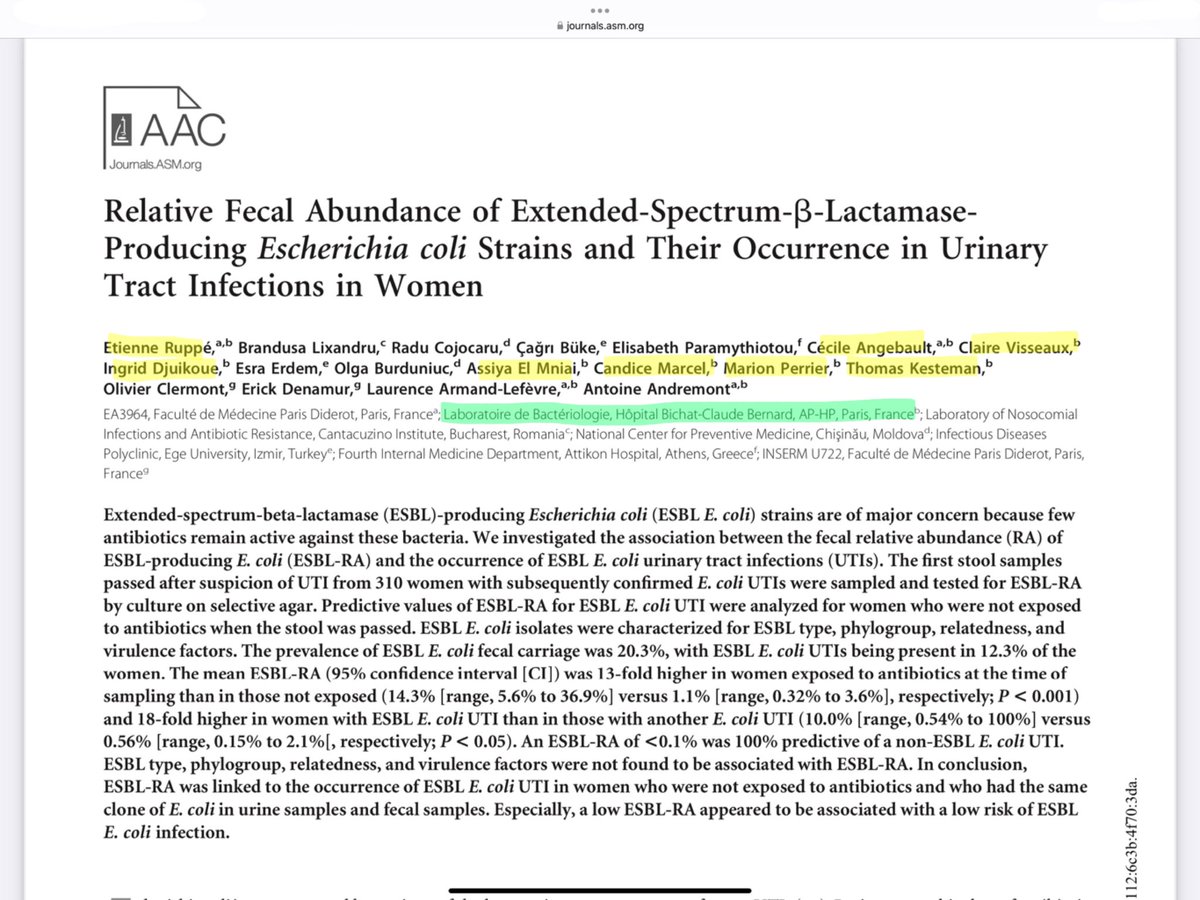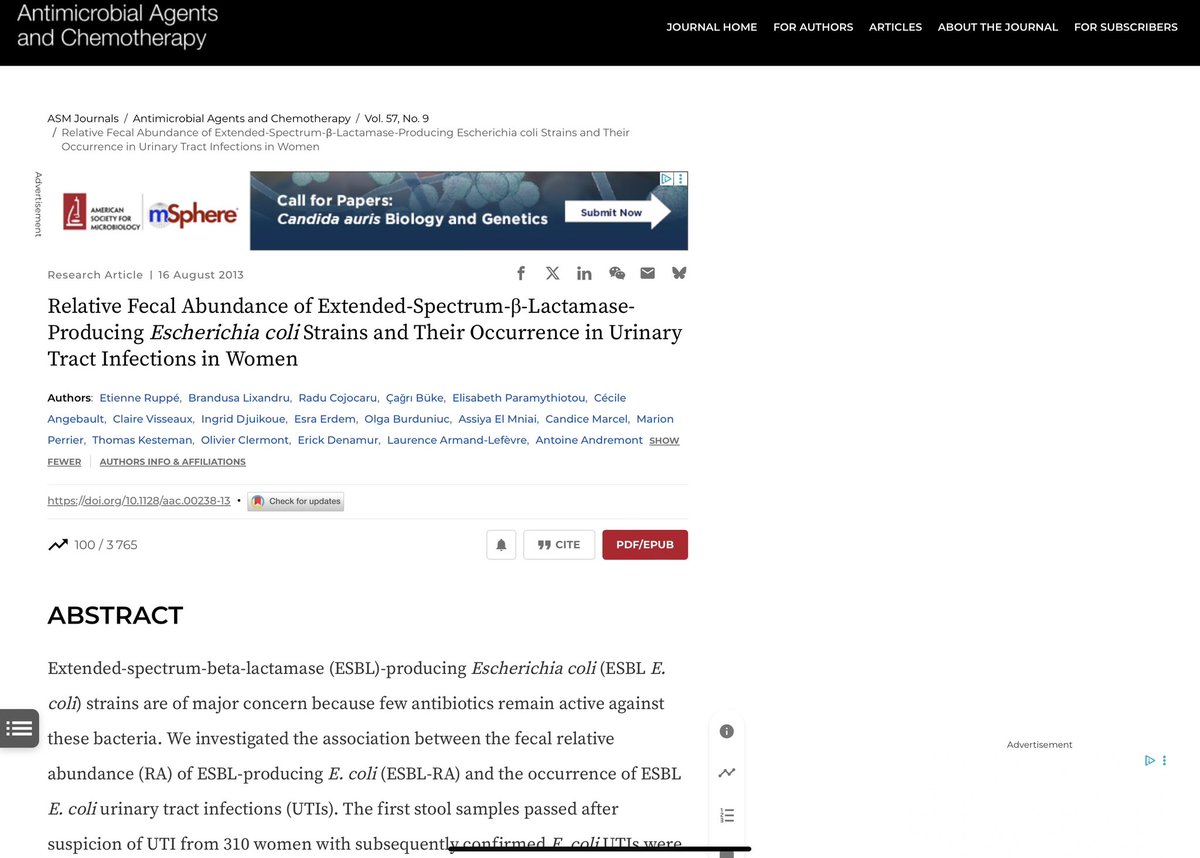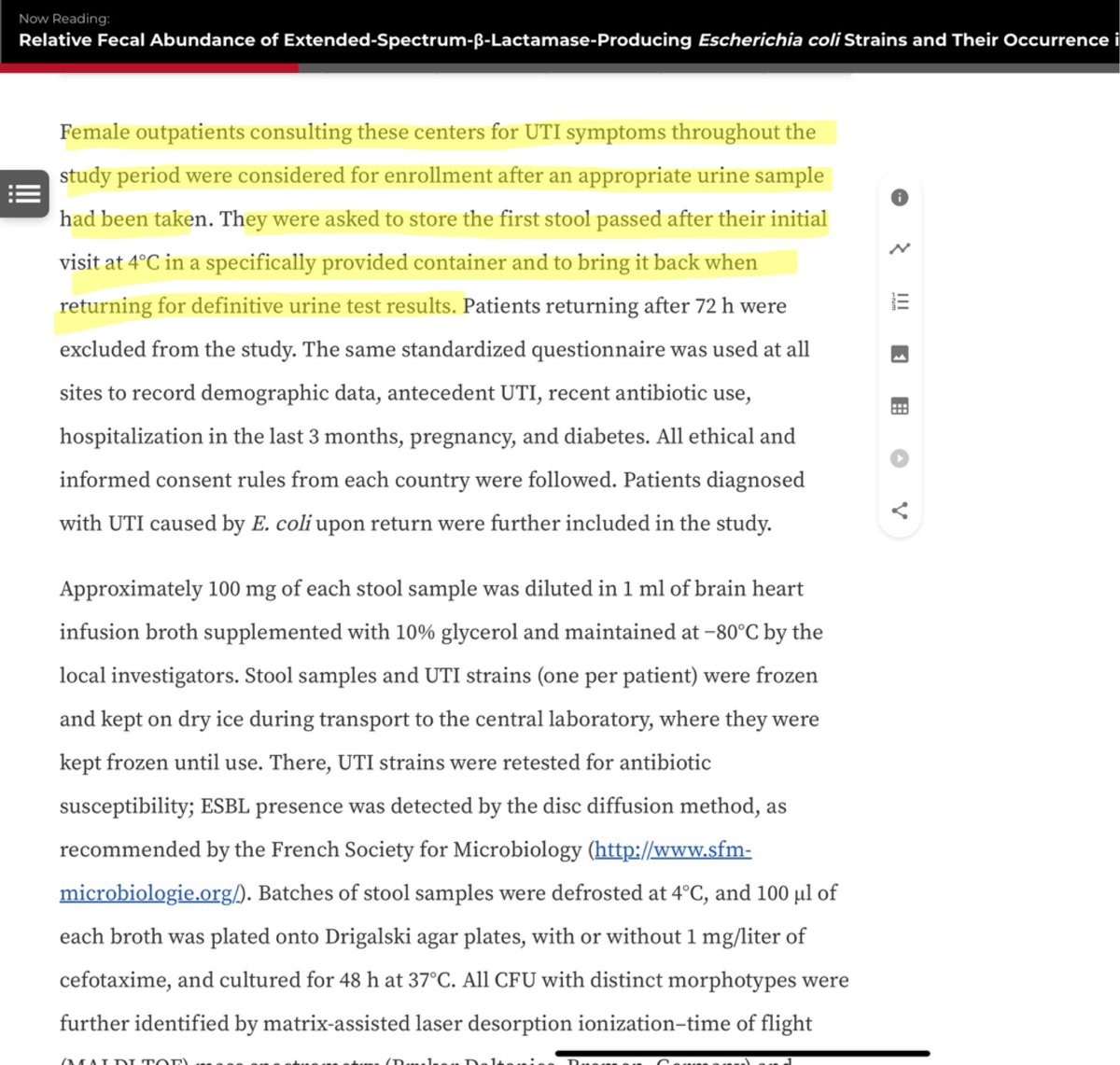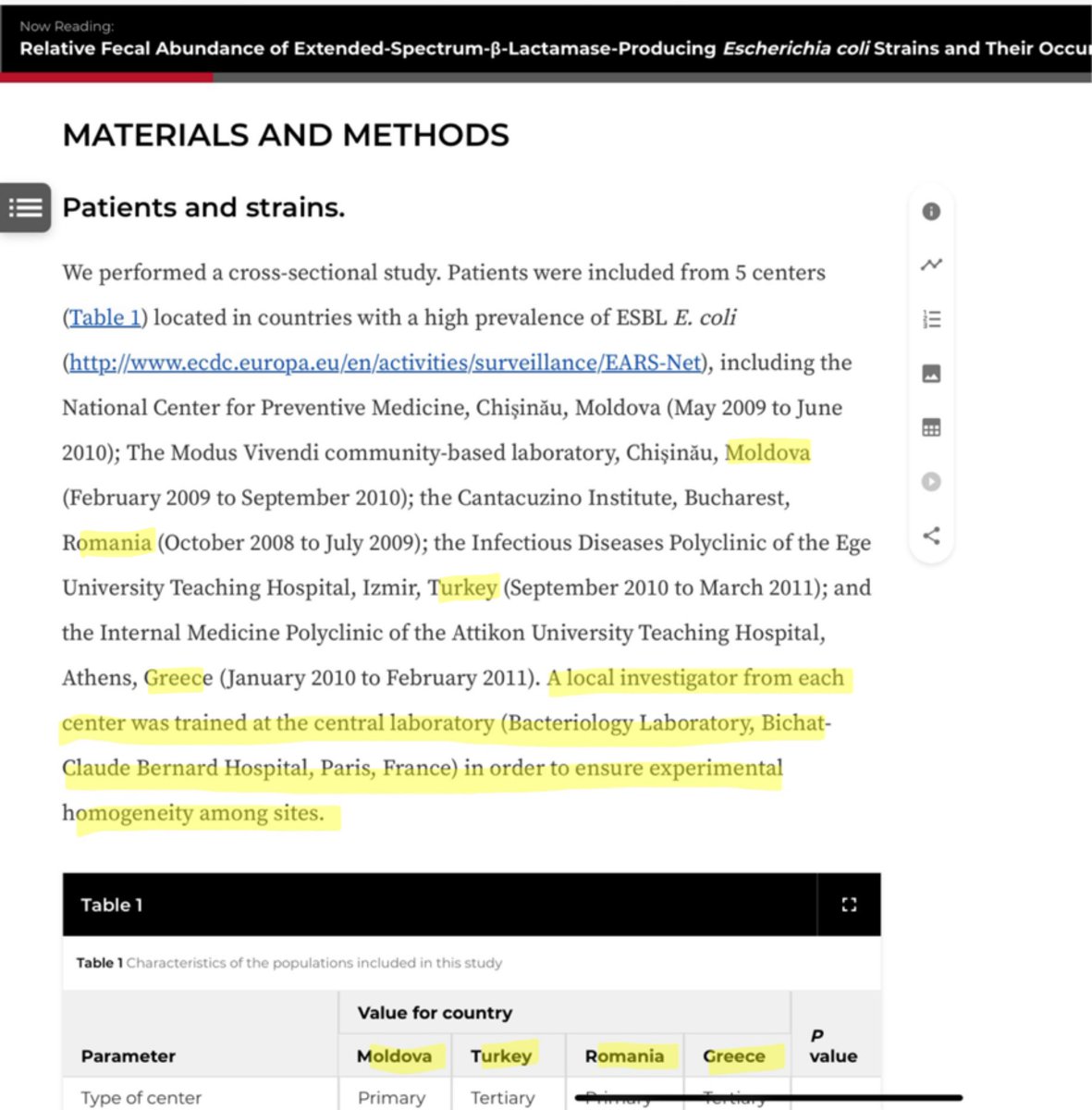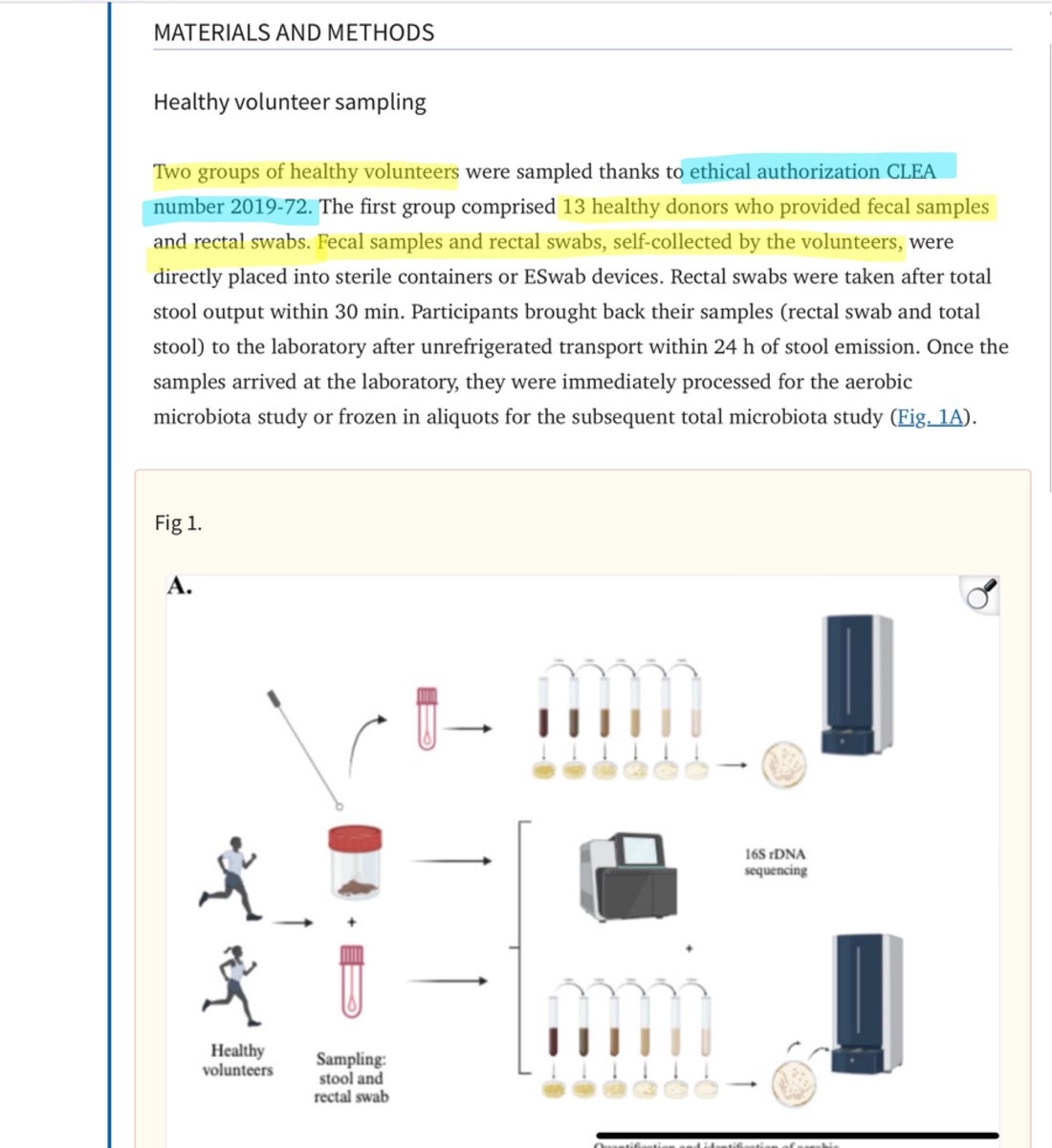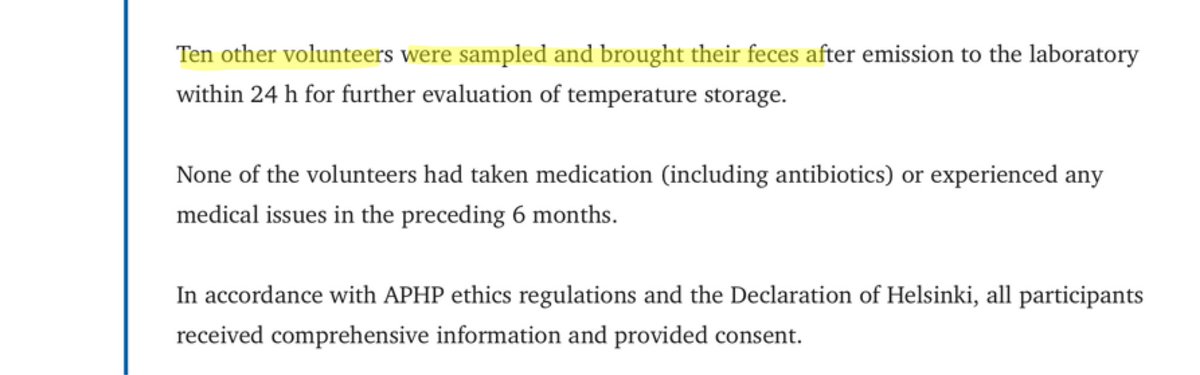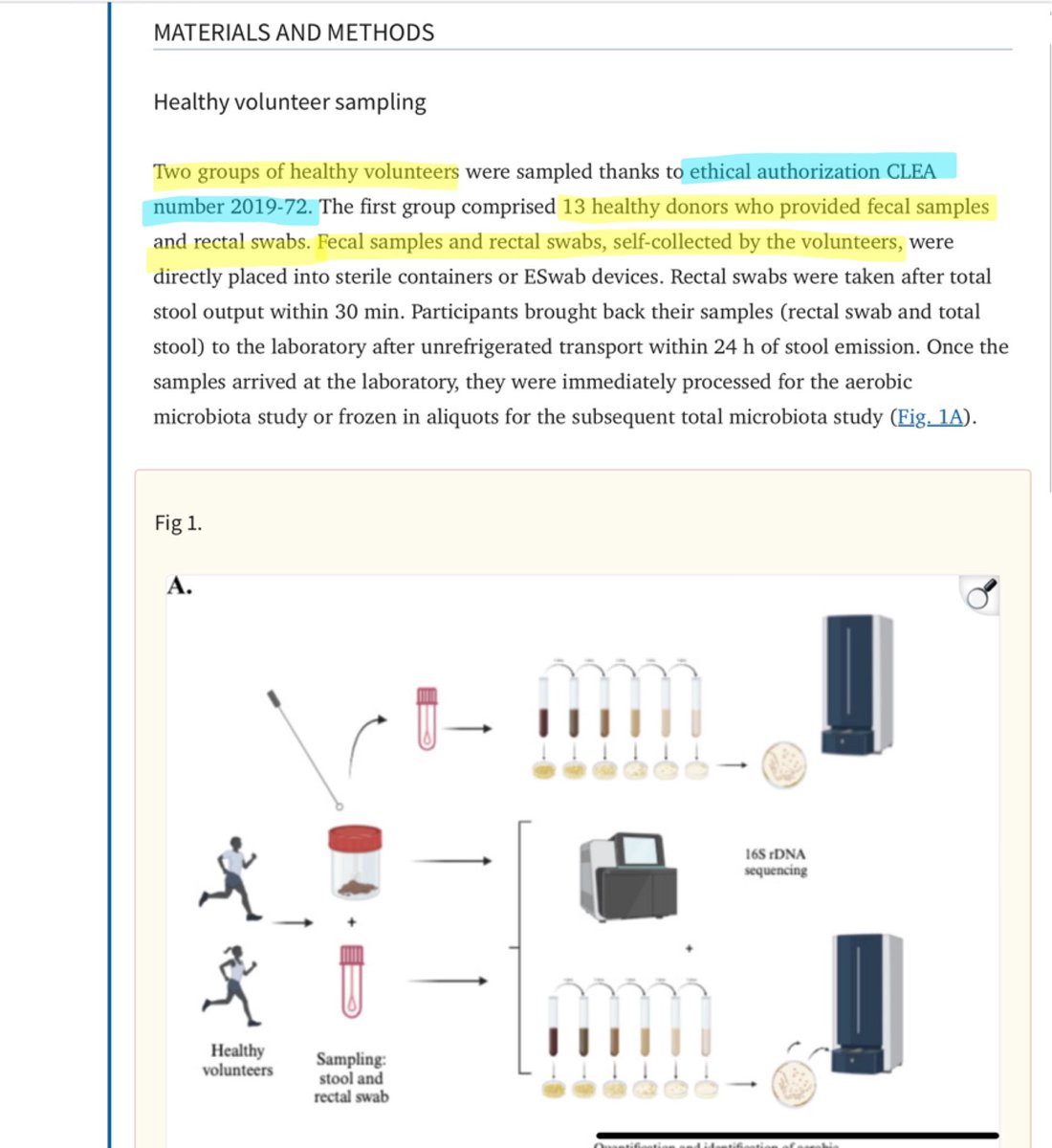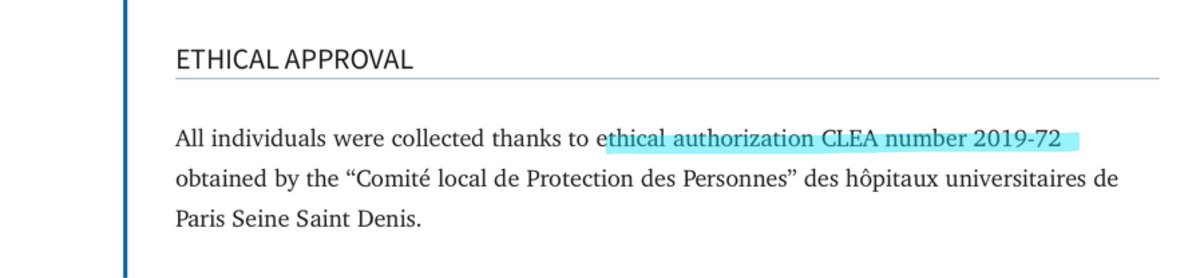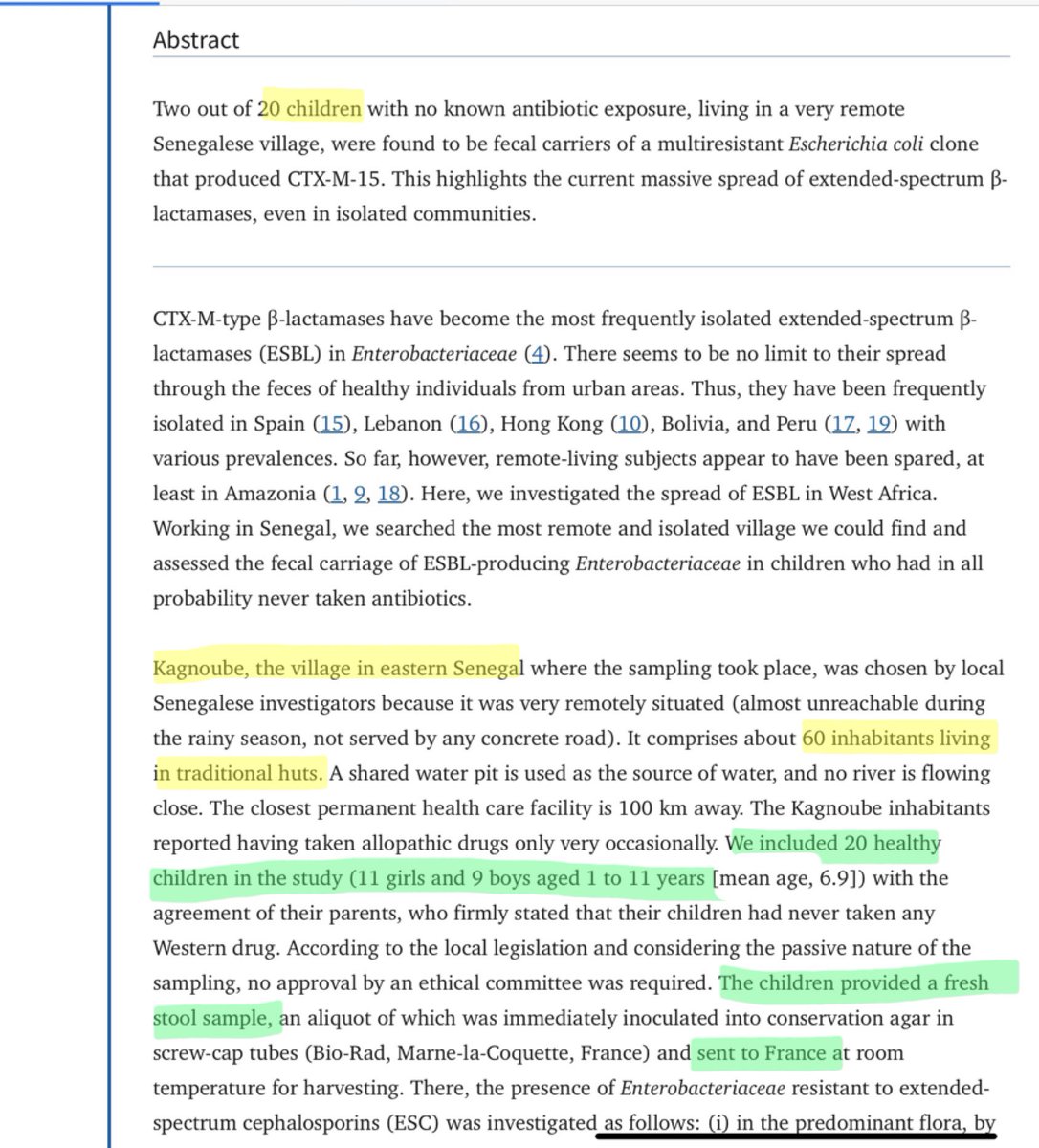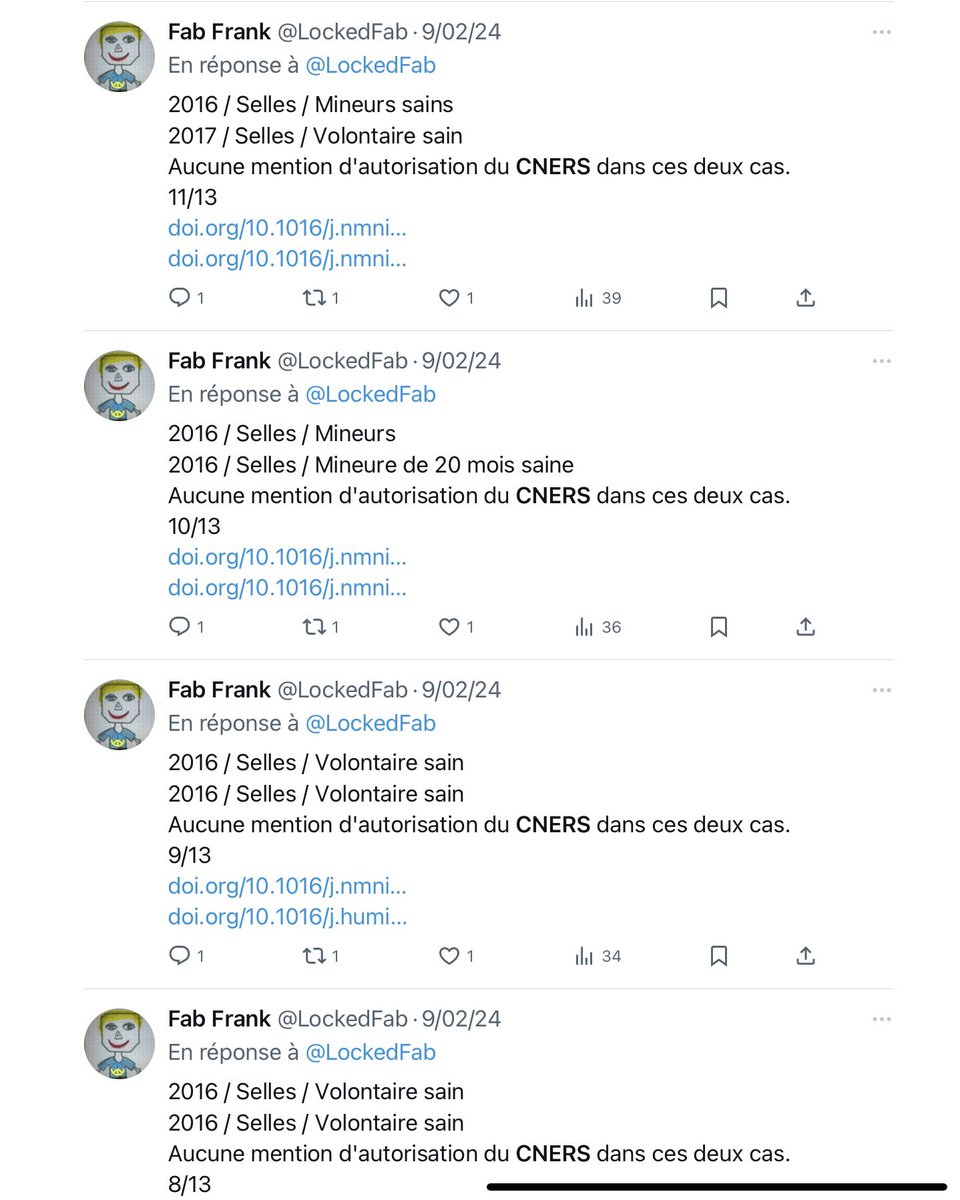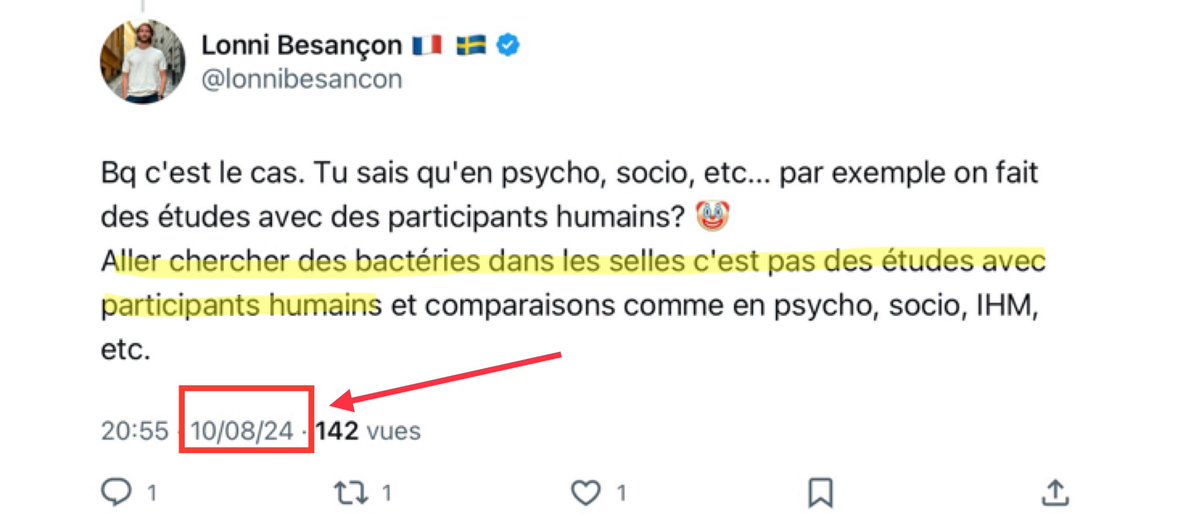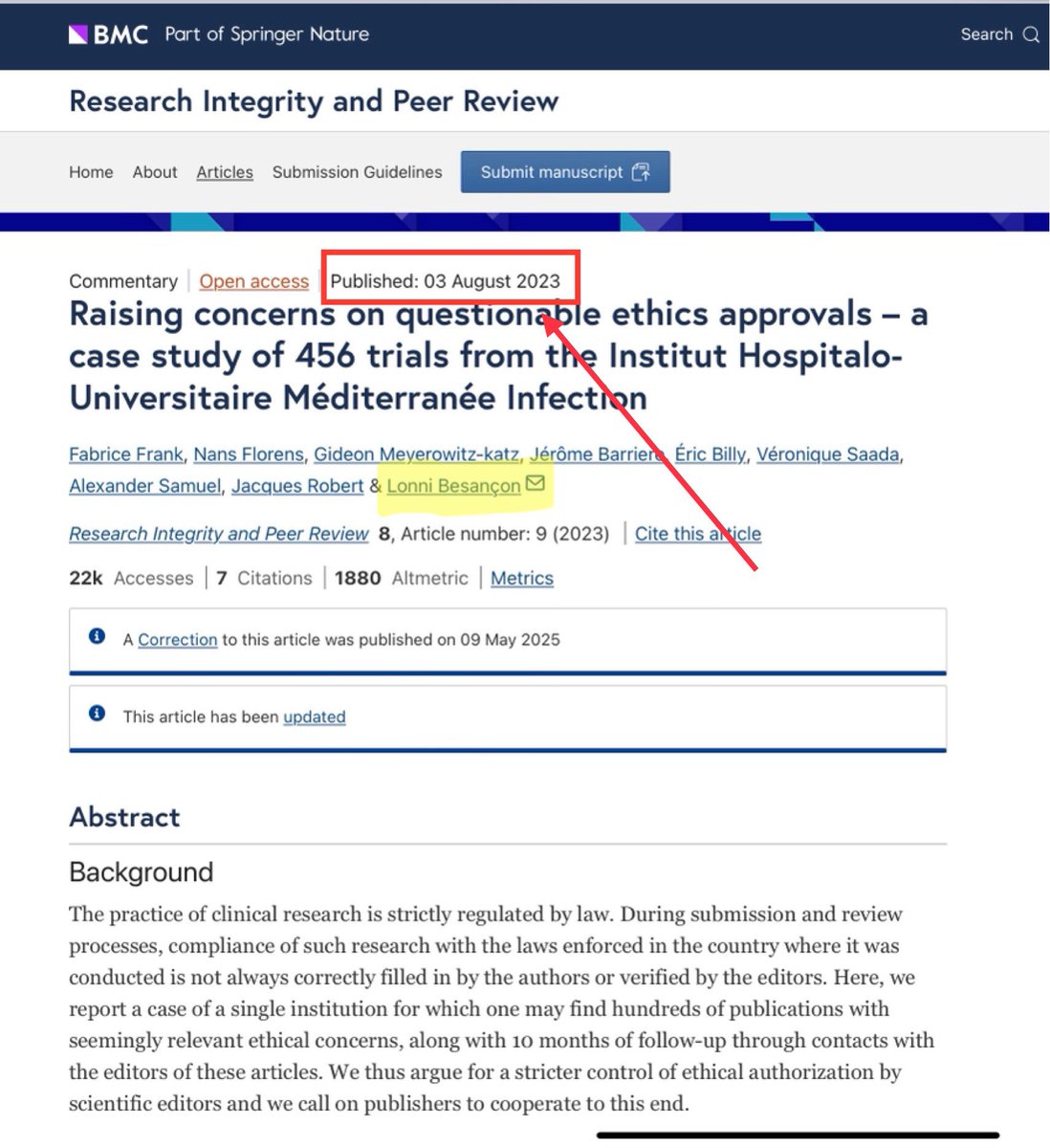1/n Rétractation Pradelle et al. : preuve supplémentaire de la fabrication de données aboutissant à des résultats aberrants : ils attribuent 1822 décès à l’HCQ en Italie alors que la pharmacovigilance italienne n’en n’a recensé que 2.








2/n Une équipe de scientifiques italiens a analysé les rapports des effets indésirables de l’HCQ reçus par leur réseau national de pharmacovigilance du 1er mars 2020 au 31 mai 2020.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
3/n Leurs résultats ont été publiés le 5 janvier 2022 et étaient donc à la disposition de Pradelle et al. s’ils voulaient confronter leur modèle aux chiffres réels. Vérifier ses hypothèses, c’est la base de la démarche scientifique.
4/n Une telle discordance aurait dû les alerter sur les problèmes de leur méthodologie. Car même s’il est reconnu que la pharmacologie passive sous-estime les effets secondaires, ce n’est néanmoins pas plausible qu’il y ait eu 911 fois plus de décès que ce qui a été rapporté.
5/n D’autant que les médecins avaient été alertés des effets secondaires potentiels de l’HCQ et qu’ils ont donc été vigilants sur ce sujet.
6/n Cette publication montre qu’un système de pharmacovigilance pro-active multiplie par 4 le nombre de déclarations d’effets secondaires par rapport à un système de pharmacovigilance passive… On est bien loin d’une multiplication par plus de 900 !
pharmactuel.com/index.php/phar…

pharmactuel.com/index.php/phar…

7/n Alors, Monsieur @beauantoine, auriez-vous la gentillesse de nous expliquer par quelle méthodologie scientifiquement valide on peut en arriver à une estimation de 1822 décès dûs à l’HCQ en Italie alors que la pharmacovigilance italienne en a recensé 2 ?
8/n Car, dans votre article, Mr Bégaud nous dit que : « Pour que les revues procèdent à des retraits, il faudrait que les fautes aient conduit à faire un contresens dans la démonstration et dans les conclusions de l’article. » 

9/n S’il estime qu’une démonstration aboutissant à une conclusion de 1822 décès, n’est pas une faute aboutissant à un énorme « contresens » par rapport au chiffre réel de 2 décès, peut-il nous dire quelle autres dénomination conviendrait ?
10/n Par ailleurs, dans l’étude italienne CORIST, citée en référence 28 par Pradelle et al. les dosages utilisés sont spécifiés et conformes aux recommandations officielles italiennes : 800 mg le premier jour et 400 mg du 2ème au 5ème-7ème jour.






11/n Les auteurs de l’étude CORIST spécifient également que Recovery (leur référence 39) utilise un dosage qui représente le double de celle qu’ils administrent en Italie dans leurs conditions de vie réelle. 

13/n Pourquoi Pradelle et al. ont-ils utilisé des « valeurs moyennes » alors que, dans leur propre source, ils disposaient des dosages précis réellement utilisés en Italie ? Est-ce une pratique scientifiquement valide pour évaluer les effets pharmacologiques d’une molécule ?
14/n L’éditeur n’a-t-il pas raison d’estimer que la toxicité d’un médicament ne peut se mesurer de manière rigoureuse que si elle se fait sur les doses précises réellement utilisées ?




15/n Mais en fait, Pradelle et al. n’ont pas utilisé des valeurs moyennes de dosages d’HCQ. Ils ont appliqué l’augmentation du risque de mortalité (OR = 1,11) des patients de l’étude Recovery ayant reçu des doses élevées à des patients ayant reçu des doses 2 fois plus faibles 

16/n Mais pourquoi donc ont-ils fait ce choix ? Alors qu’en plus de l’étude CORIST leur permettant de connaître les doses précises utilisées, Pradelle et al. auraient pu utiliser cette autre méta-analyse faite précédemment par leurs collègues italiens. 

18/n Cette méta-analyse reprend 11 essais cliniques randomisés RCT et 25 études rétrospectives de cohortes s’étant déroulées dans de nombreux pays. Les auteurs fournissent un tableau reprenant les dosages précis utilisés.






19/n Les auteurs indiquent également la dose totale reçue par les patients durant tout le traitement.
20/n Ce qui est le plus intéressant, c’est qu’ils donnent le risque de mortalité selon les dosages faibles ou élevés des RCT : ils ont constaté 15 % de sous-mortalité dans les RCT utilisant des dosages faibles et 10 % de SURMORTALITÉ dans les RCT utilisant des dosages ÉLEVÉS 

21/n Dans leur matériel supplémentaire (figure 2), on trouve également des détails précieux :
⁃non RCT : dose totale < ou = 4000 mg : sous-mortalité : OR : 0,67
⁃RCT : dose totale < ou = 4000 mg : sous-mortalité : OR : 0,85
⁃non RCT : dose totale < ou = 4000 mg : sous-mortalité : OR : 0,67
⁃RCT : dose totale < ou = 4000 mg : sous-mortalité : OR : 0,85

22/n
⁃non RCT : dose totale > 4000 mg : sous-mortalité : OR : 0,85
⁃RCT dose totale > 4000 mg : surmortalité : OR : 1,10
⁃non RCT : dose totale > 4000 mg : sous-mortalité : OR : 0,85
⁃RCT dose totale > 4000 mg : surmortalité : OR : 1,10

23/n Cette méta-analyse ayant été publiée en juin 2021, Pradelle et al. avaient donc la possibilité d’y trouver le calcul des risques selon les dosages faibles ou élevés et d’appliquer l’OR correspondant aux doses utilisées dans les pays qu’ils ont étudiés.
24/n Quoi qu’en dise Mr Molimard, les essais publiés à 400 mg ne vont pas dans le sens d’une augmentation du risque de mortalité… bien au contraire…




25/n Même la méta-analyse Axfors que Pradelle et al. utilisent comme référence indique que les faibles dosages ont un OR inférieur à celui des dosages élevés (0,97 versus 1,12)
https://x.com/lolowarn/status/1831236905804939334?s=61
26/n Et faire le choix d’appliquer le risque de surmortalité des dosages élevés à des patients ayant reçu des dosages faibles démontre l’intention de fabriquer des résultats qui vont à l’inverse de la réalité.
27/n Comme dans cet exemple pour l’Italie : dosages faibles (800 mg le premier jour et 400 m les jours suivants : 2400 mg au total) : l’OR est de 0,85 mais Pradelle et al. ont appliqué l’OR des RCT à dosages élevés (1,11).




28/n Ils aboutissent alors à 1822 décès alors que la pharmacovigilance n’en n’a recensé que deux…
CQFD.


CQFD.


• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh