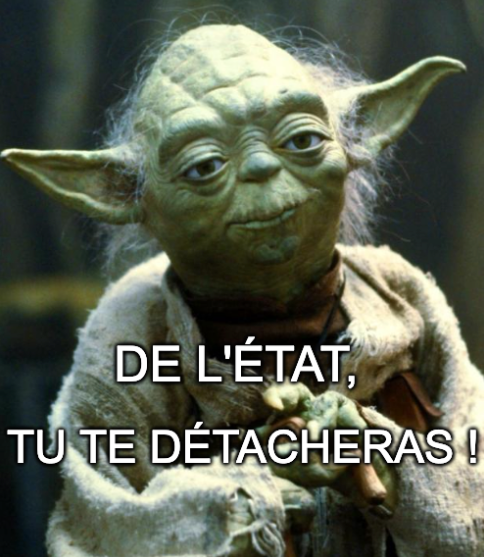Pourquoi les Français sont-ils si nuls en économie ?
Un fil pédagogique pour comprendre ce qui cloche dans ce foutu pays.👇
Un fil pédagogique pour comprendre ce qui cloche dans ce foutu pays.👇

Je parle ici des Français parce que je fréquente des Français et que je m’appuie sur mon expérience. Évidemment, généraliser en disant "les Français" est déjà quelque peu grossier. Il me semble que la compréhension économique est faible partout dans le monde. Cela dépasse largement la France, sachant que tous les Français ne sont pas concernés.
Par ailleurs, il ne faut pas confondre certains réflexes pro-business ou un goût pour l’indépendance avec la culture économique en soi. Ici, je parle bien de connaissances élémentaires mais indispensables servant à déjouer les pièges étatistes. Voici donc un top 10 de fausses croyances économiques qui gangrènent toujours les esprits Français.
Par ailleurs, il ne faut pas confondre certains réflexes pro-business ou un goût pour l’indépendance avec la culture économique en soi. Ici, je parle bien de connaissances élémentaires mais indispensables servant à déjouer les pièges étatistes. Voici donc un top 10 de fausses croyances économiques qui gangrènent toujours les esprits Français.
1️⃣ Les Français oublient le rôle de la production
Ils demandent souvent de "mieux répartir les richesses" (déjà un abus de langage, puisque la richesse se démultiplie à l'échange) sans se poser ces questions fondamentales : d'où vient la richesse ? Qui produit ? Avec quelles incitations ? Sans production préalable, aucune richesse ne peut émerger.
2️⃣ Les Français croient que l’État peut tout financer sans limites
Dans la même idée, ils imaginent que "l’État paiera" pour tout. Or, l’État ne finance ses dépenses qu’en prélevant de l'argent via les impôts, les emprunts ou la création monétaire. En clair, ce sont les Français eux-mêmes qui paient pour tout.
3️⃣ Les Français sont incapables de voir les coûts cachés de l’économie
Ils se réjouissent des aides, des subventions et des plans de relance sans percevoir ce qu’ils condamnent, à savoir des projets et des investissements non réalisés. Leur attention est toujours portée sur ce qui se voit, jamais sur ce qui ne se voit pas.
Ils demandent souvent de "mieux répartir les richesses" (déjà un abus de langage, puisque la richesse se démultiplie à l'échange) sans se poser ces questions fondamentales : d'où vient la richesse ? Qui produit ? Avec quelles incitations ? Sans production préalable, aucune richesse ne peut émerger.
2️⃣ Les Français croient que l’État peut tout financer sans limites
Dans la même idée, ils imaginent que "l’État paiera" pour tout. Or, l’État ne finance ses dépenses qu’en prélevant de l'argent via les impôts, les emprunts ou la création monétaire. En clair, ce sont les Français eux-mêmes qui paient pour tout.
3️⃣ Les Français sont incapables de voir les coûts cachés de l’économie
Ils se réjouissent des aides, des subventions et des plans de relance sans percevoir ce qu’ils condamnent, à savoir des projets et des investissements non réalisés. Leur attention est toujours portée sur ce qui se voit, jamais sur ce qui ne se voit pas.
4️⃣ Les Français confondent emploi et valeur générée
Ils supposent qu’un emploi créé est toujours bénéfique. Mais un emploi qui ne génère pas de valeur pour autrui ou qui en détruit pour exister (comme un emploi subventionné) n’est pas un progrès économique : c’est un transfert de ressources qui appauvrit d’autres secteurs.
5️⃣ Les Français méconnaissent le rôle des prix
Ils ne comprennent pas ce qu’ils reflètent. Les prix transmettent des informations sur la rareté, la demande et les coûts dans une économie. C'est pourquoi lorsque l'État manipule les prix, il brouille les signaux qui coordonnent l’activité des agents économiques.
6️⃣ Les Français raisonnent de façon collectiviste au lieu de raisonner à partir de l'individu
Ils parlent de "sauver des secteurs", de "sauver l’hôpital" ou de "sauver l’école", comme si l’économie était faite de blocs abstraits sur lesquels agir d'en haut. Pourtant, l'économie repose sur des millions de décisions individuelles, d’échanges et d’ajustements quotidiens. On ne peut pas décréter la prospérité : il est seulement possible d'en créer les conditions par le libre marché.
Ils supposent qu’un emploi créé est toujours bénéfique. Mais un emploi qui ne génère pas de valeur pour autrui ou qui en détruit pour exister (comme un emploi subventionné) n’est pas un progrès économique : c’est un transfert de ressources qui appauvrit d’autres secteurs.
5️⃣ Les Français méconnaissent le rôle des prix
Ils ne comprennent pas ce qu’ils reflètent. Les prix transmettent des informations sur la rareté, la demande et les coûts dans une économie. C'est pourquoi lorsque l'État manipule les prix, il brouille les signaux qui coordonnent l’activité des agents économiques.
6️⃣ Les Français raisonnent de façon collectiviste au lieu de raisonner à partir de l'individu
Ils parlent de "sauver des secteurs", de "sauver l’hôpital" ou de "sauver l’école", comme si l’économie était faite de blocs abstraits sur lesquels agir d'en haut. Pourtant, l'économie repose sur des millions de décisions individuelles, d’échanges et d’ajustements quotidiens. On ne peut pas décréter la prospérité : il est seulement possible d'en créer les conditions par le libre marché.
7️⃣ Les Français se méfient de l’enrichissement
Ils perçoivent le succès économique comme suspect, comme s’il était associé à l’exploitation ou à la tricherie. Ils oublient qu’en régime de marché, l’enrichissement honnête découle de l’échange volontaire et de la capacité à répondre aux besoins comme aux désirs humains. Ils oublient donc que c'est le consommateur qui permet l'enrichissement de certains et pas d'autres.
8️⃣ Les Français privilégient le court terme
En lien avec le point 3️⃣, ils valorisent des avantages immédiats sans réfléchir aux conséquences à long terme pour eux. Dette publique, désincitations à la production, inflation chronique, blocages sur le marché, effets d’aubaine etc. Ils se condamnent eux-mêmes à payer davantage plus tard en disant amen au moindre privilège reposant sur l’extorsion aujourd'hui.
9️⃣ Les Français ont reçu une éducation économique idéologique et morale, pas scientifique
Ils ont appris que l’économie devait être contrôlée par l'État, seul acteur en mesure de corriger des "injustices" et des "déséquilibres" générés par le marché. Pourtant, l'économie est une science de l’action humaine centrée sur la production, l’allocation des ressources et l’échange dans un monde touché par la rareté. Elle consiste à observer les phénomènes sociaux, comprendre la mécanique de la création de richesses, déduire des lois, anticiper des effets etc. Quel rapport avec la "justice sociale" (= spoliations arbitraires) ?
🔟 Les Français opposent faussement économie et humanité
Ils voient l’économie comme une discipline peu fiable et surtout, opposée à "l’humain". Cela est notamment vrai du capitalisme comme système économique. Pourtant, ce dernier repose sur le principe de non-agression. Commercer suppose de renoncer à la violence. Plus encore, le capitalisme de libre marché est la condition même de l’amélioration de nos conditions de vie (hausse du pouvoir d’achat, accès élargi aux biens et services etc).
Ils perçoivent le succès économique comme suspect, comme s’il était associé à l’exploitation ou à la tricherie. Ils oublient qu’en régime de marché, l’enrichissement honnête découle de l’échange volontaire et de la capacité à répondre aux besoins comme aux désirs humains. Ils oublient donc que c'est le consommateur qui permet l'enrichissement de certains et pas d'autres.
8️⃣ Les Français privilégient le court terme
En lien avec le point 3️⃣, ils valorisent des avantages immédiats sans réfléchir aux conséquences à long terme pour eux. Dette publique, désincitations à la production, inflation chronique, blocages sur le marché, effets d’aubaine etc. Ils se condamnent eux-mêmes à payer davantage plus tard en disant amen au moindre privilège reposant sur l’extorsion aujourd'hui.
9️⃣ Les Français ont reçu une éducation économique idéologique et morale, pas scientifique
Ils ont appris que l’économie devait être contrôlée par l'État, seul acteur en mesure de corriger des "injustices" et des "déséquilibres" générés par le marché. Pourtant, l'économie est une science de l’action humaine centrée sur la production, l’allocation des ressources et l’échange dans un monde touché par la rareté. Elle consiste à observer les phénomènes sociaux, comprendre la mécanique de la création de richesses, déduire des lois, anticiper des effets etc. Quel rapport avec la "justice sociale" (= spoliations arbitraires) ?
🔟 Les Français opposent faussement économie et humanité
Ils voient l’économie comme une discipline peu fiable et surtout, opposée à "l’humain". Cela est notamment vrai du capitalisme comme système économique. Pourtant, ce dernier repose sur le principe de non-agression. Commercer suppose de renoncer à la violence. Plus encore, le capitalisme de libre marché est la condition même de l’amélioration de nos conditions de vie (hausse du pouvoir d’achat, accès élargi aux biens et services etc).
Toutes ces confusions sont largement entretenues par :
- une tradition jacobine très ancrée au sein de laquelle l’État est perçu comme l'organisateur naturel et légitime de la société
- une histoire intellectuelle marquée par différents socialismes d'État
- des facultés où l’économie n’est pas enseignée comme une science axiomatique et logique découlant de l'action humaine, mais empirique et morale
- des médias dominés par des narratifs étatistes, égalitaristes et méfiants de l’entreprise
- un tabou vis-à-vis du succès du succès économique
Fort heureusement, de même qu’il est possible de se laisser illusionner sur la nature de l’économie, il est possible de la réapprendre afin de corriger ses erreurs passées. L’inculture économique n’est pas une fatalité ! Chaque prise de conscience individuelle est donc un progrès à accueillir ! Et vous, où en êtes-vous de votre culture économique ?
- une tradition jacobine très ancrée au sein de laquelle l’État est perçu comme l'organisateur naturel et légitime de la société
- une histoire intellectuelle marquée par différents socialismes d'État
- des facultés où l’économie n’est pas enseignée comme une science axiomatique et logique découlant de l'action humaine, mais empirique et morale
- des médias dominés par des narratifs étatistes, égalitaristes et méfiants de l’entreprise
- un tabou vis-à-vis du succès du succès économique
Fort heureusement, de même qu’il est possible de se laisser illusionner sur la nature de l’économie, il est possible de la réapprendre afin de corriger ses erreurs passées. L’inculture économique n’est pas une fatalité ! Chaque prise de conscience individuelle est donc un progrès à accueillir ! Et vous, où en êtes-vous de votre culture économique ?
Si ce petit fil vous a plu, faites-le moi savoir en commentaires ! Et pensez à vous abonner à mon compte : @arthurhomines
Par ailleurs, je profite de l'occasion pour remettre en avant mon cours d'économie "Six Leçons", inspiré par le livre du grand économiste autrichien Ludwig von Mises. Le cours a été conçu aux côtés de @StephaneGeyres et vous apporte toutes les bases nécessaires en économie. Au programme :
✦ Leçon 1 : le capitalisme
✦ Leçon 2 : le socialisme
✦ Leçon 3 : l'interventionnisme
✦ Leçon 4 : l'inflation
✦ Leçon 5 : l'investissement étranger
✦ Leçon 6 : la politique et les idées
J’y ai récemment ajouté quelques compléments pour approfondir les leçons déjà fournies, toujours dans cet esprit d’explications sans fioritures.
✦ Leçon BONUS #1 : l'action humaine, l'échange et la valeur
✦ Leçon BONUS #2 : la monnaie et les prix
✦ Leçon BONUS #3 : la production, le capital et l'entrepreneur
👨🏻🏫 Pour accéder au cours, vous avez deux options :
1️⃣ Sur mon Académie :
▶︎ academiahomines.com/p/six-lecons-m…
Abonnez-vous au niveau "Culture Liberté" pour accéder au cours (paiement récurrent annuel, résiliable à tout instant). Vous aurez accès à tous les cours suivants (dès septembre) mais aussi à l'ensemble de mes contenus déjà partagés, et surtout à venir.
2️⃣ Sur ma plateforme secondaire :
▶︎ cours.academiahomines.com/six-lecons
Le tarif restera à 37€ (paiement une seule fois) jusqu'au 31 août, puis passera à 57€ en raison de la mise à jour apportée. Cela vous laisse largement le temps de souscrire au cours à moindre prix.
Par ailleurs, je profite de l'occasion pour remettre en avant mon cours d'économie "Six Leçons", inspiré par le livre du grand économiste autrichien Ludwig von Mises. Le cours a été conçu aux côtés de @StephaneGeyres et vous apporte toutes les bases nécessaires en économie. Au programme :
✦ Leçon 1 : le capitalisme
✦ Leçon 2 : le socialisme
✦ Leçon 3 : l'interventionnisme
✦ Leçon 4 : l'inflation
✦ Leçon 5 : l'investissement étranger
✦ Leçon 6 : la politique et les idées
J’y ai récemment ajouté quelques compléments pour approfondir les leçons déjà fournies, toujours dans cet esprit d’explications sans fioritures.
✦ Leçon BONUS #1 : l'action humaine, l'échange et la valeur
✦ Leçon BONUS #2 : la monnaie et les prix
✦ Leçon BONUS #3 : la production, le capital et l'entrepreneur
👨🏻🏫 Pour accéder au cours, vous avez deux options :
1️⃣ Sur mon Académie :
▶︎ academiahomines.com/p/six-lecons-m…
Abonnez-vous au niveau "Culture Liberté" pour accéder au cours (paiement récurrent annuel, résiliable à tout instant). Vous aurez accès à tous les cours suivants (dès septembre) mais aussi à l'ensemble de mes contenus déjà partagés, et surtout à venir.
2️⃣ Sur ma plateforme secondaire :
▶︎ cours.academiahomines.com/six-lecons
Le tarif restera à 37€ (paiement une seule fois) jusqu'au 31 août, puis passera à 57€ en raison de la mise à jour apportée. Cela vous laisse largement le temps de souscrire au cours à moindre prix.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh