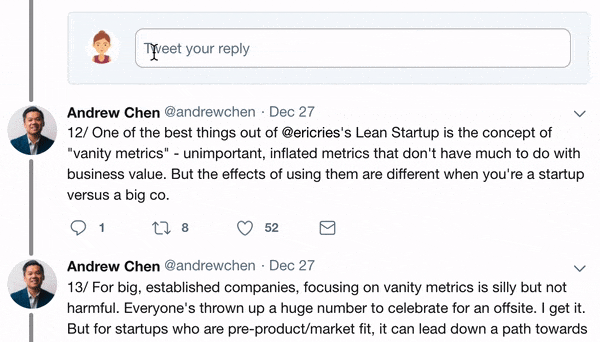Ce Noël est un peu particulier pour moi et j’ai envie de le partager avec vous. Je me lance dans un fil sans trop savoir comment je vais l’articuler ni quelle en sera la destination précise. Qui lira verra, comme on dit (presque).
Je vais vous parler de #chocolat.
Je vais vous parler de #chocolat.
Feu mon père, qui est parti « jouer de la harpe avec saint Pierre » – c’était son expression favorite pour parler de l’au-delà – il y a deux ans et demi déjà, aimait ce qui était simple et essentiel.
En totale contradiction avec ce goût pour la sobriété, il travaillait dans un des mondes les plus frivoles qui soient : la confiserie-chocolaterie.
Il était « voyageur représentant de commerce », comme on disait alors – je ne suis pas sûr que cela se dise encore – pour diverses entreprises du secteur. Des PME qui fabriquaient des bonbons, des chocolats, des boîtes, des sachets, des rubans – très important, les rubans –, etc.
Il travaillait donc à vendre tout cela à une myriade de clients pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, dans à peu près tout le quart nord-est de la France. Il a fait ça pendant une trentaine d’années, de 1956 à 1987.
Il aimait ça. Ça n’était pas marrant tous les jours – il fallait lutter contre les clients qui, à peine avait-il franchi la porte de leur boutique –, lui lançaient : « On n’a besoin de rien ! » Mais il aimait ça. Il finissait (presque) toujours par leur vendre quelque chose.
Il avait l’art de trouver des petites astuces commerciales pour aider ses clients à mieux vendre leurs produits.
Je me rappelle une anecdote, entendue quand j’étais enfant. Il existait alors à Nancy, rue Saint-Jean, une belle et grande confiserie appelée Royal Stanislas.
La patronne, un jour, se lamentait qu’un type de bonbon qu’elle lui avait acheté se vendait mal et lui restait sur les bras. Si je me souviens bien, c’était en raison de la couleur du papier qui les emballait ; disons orange.
Résultat : elle n’avait plus très envie de lui acheter ces bonbons – qui pourtant étaient excellents, je suis bien placé pour le savoir, je boulottais tous les échantillons que je trouvais à la maison.
Pire : elle voulait qu’il lui reprenne ses invendus.
Mon père : « Tûtûtût. Je sais comment vous allez faire pour les vendre, ces bonbons. »
« Vous allez m’acheter des bonbons marron, des sachets cellophane et ce joli ruban jaune et vert, vous mélangez les bonbons orange et marron, vous faites des sachets de 100 g, un beau flot, vous appelez ça « méli-mélo d’automne » et hop, ça va se vendre comme des petits pains.
La patronne : « Ah oui. Pas bête. » Elle a fait comme mon père lui a dit et ça s’est vendu comme des petits pains, surtout que c’était l’automne.
Bref. Mon père aimait beaucoup le contact humain propre à ce métier, à une époque où les tableaux Excel n’existaient pas et où le commerce consistait surtout à ce que tout le monde y trouve son compte.
Au fil des années, ses clients devenaient des amis. Certains étaient très proches. Je me rappelle des noms entendus mille fois à la maison quand j’étais enfant.
Waïda à Reims, Descat à Saint-Dié, Passetemps à Pont-Saint-Vincent, Schwartz à Rambervillers, Lalonde à Nancy, Mentré à Charmes (un lointain cousin), etc.
À Lunéville, il y avait plusieurs pâtissiers chocolatiers avec lesquels mon père travaillait. Parmi eux, la maison Valance. Du nom de Marceau Valance. Un type de la région qui avait la passion du chocolat.
Il était né à Raon-l’Étape, petite bourgade des Vosges, en 1929. Après son apprentissage de pâtissier, il n’avait qu’une idée en tête : filer à Bâle, en Suisse, où se trouvait une très prestigieuse école de chocolaterie : la Coba. Il y est allé.
Il s’y est formé puis a roulé sa cabosse en Suisse, à Calais, à Paris, un peu partout. La trentaine approchant, il a eu envie de s’établir à son compte. Une pâtisserie était à vendre à Lunéville, rue Banaudon, alors tenue par la famille Lorrain.
(En exclu mondiale, voici le « père Lorrain », Léon de son prénom, dont certains secrets de fabrication feraient trembler les âmes sensibles, mais là n’est pas le sujet. #vieuxdossiers) 

Marceau Valance rachète la pâtisserie en 1958. On lui présente la jeune vendeuse, qui s’appelle Françoise. Il est célibataire. Elle est célibataire. Ils ne tardent pas à se marier. Et vogue le navire.
Marceau a la niaque et de l’ambition. Il existe alors une dizaine de « pâtissiers purs » à Lunéville. Il veut être le meilleur, voire rattraper la maison N******, qui tient le haut de la dragée dans cette cité alors dite « cavalière ».
Il travaille avec mon père, à qui il achète toutes les fournitures dont il a besoin : boîtes, sachets, sacs, rubans – très important, les rubans –, étiquettes, caissettes en papier, etc.
Ils s’entendent bien et sont de bons amis. La maison Valance fonctionne bien. Marceau est un excellent pâtissier, un chocolatier très doué et gravit rapidement les marches jusqu’au sommet.
Dans les années 1970-1980, il est, on peut le dire, à égalité avec la fameuse maison N******. Il est l’un des meilleurs pâtissiers de la région.
Vient le moment où, comme tout bon chocolatier de bonne renommée qui se respecte, il veut créer une spécialité rien qu’à lui. Un chocolat unique, qui sera sa signature, et qu'il veut relier à l’histoire de Lunéville, qui est, il le dit lui-même, particulièrement riche.
Et c’est là que mon père intervient. Les spécialités, c’est son truc. ll n’a pas son pareil pour suggérer à tel ou tel chocolatier un sujet, un thème, un détail d’histoire locale pour en faire une spécialité.
Il a toujours une idée originale qui fait mouche et a contribué, mine de rien, à pas mal de créations chocolatières.
Bref, « le grand Marceau », comme on le surnommait – il était très grand, au moins 1,90 m – cherche un sujet de spécialité. Tout naturellement, il en parle à mon père. Lequel lui sort tout de go : « Panpan. »
« Tu vas faire un chocolat qui va s’appeler Panpan. »
« Qui que c’est ça hein quoi ? », a dû lui répondre Marceau.
Mon père lui a raconté l’histoire de François-Antoine Devaux. Né à Lunéville en 1712 de « noble roture » – son père était chirurgien major de la garde suisse du duc Léopold – c’est un garçon qui ne fait rien de bon mais qui a de l’esprit. Beaucoup d’esprit. Et de finesse.
Sa nourrice l’a surnommé « Panpan », un sobriquet paraît-il couramment donné aux petits François en Lorraine au XVIIIe siècle. Généralement, on le perd avec l’enfance. Devaux le garde toute sa vie.
Devaux est un esprit galant qui aime conter fleurettes aux jolies femmes du château. Il a à peine 17-18 ans quand il fait la connaissance de Françoise de Graffigny, l’un des plus brillants esprits de la cour ducale et même de France.
(Mme de Graffigny est notamment connue pour ses « Lettres d’une Péruvienne », publiées en 1747 et considérées comme le premier « best-seller » de la littérature française.) 

Elle a le double de son âge et le prend sous son aile, l’introduit à la cour. Elle l’appelle par son surnom, « Panpan ». lui l’appelle « Nini ». On l’aura compris : ces deux-là ne parlent pas que littérature. Il la couvre de vers galants, elle de faveurs diverses.
Panpan devient rapidement l’esprit numéro 1 de la cour et, pour reprendre la formule d’un historien du début du XXe siècle, « la coqueluche des dames ».
Il charme tout le monde et tout le monde se veut son ami. Mme de Graffigny bien sûr, mais aussi Voltaire et Mme du Châtelet.
Mme de Boufflers, qui est à Lunéville ce que Mme de Pompadour est à Versailles, s’en empare à son tour. Mlle Clairon, jeune comédienne qui fera fureur au Français dans quelques années, ressent comme une insulte qu’il ne lui fasse pas la cour. Et le lui écrit. 

Pourtant, Panpan semble avoir souffert assez jeune d’une incapacité à satisfaire ses soupirantes. Il l’écrit lui-même dans ses lettres et semble s’en amuser autant que de s’en plaindre. Un curieux personnage, à vrai dire.
En outre, il n’est pas très beau et il a une voix de fausset – ce dont le roi Stanislas s’agace régulièrement. 

Mais Panpan est le parfait exemple de l’homme de cour du siècle de Louis XV, qui cultive parfaitement l’esprit français, bien avant que les Anglais n’importent l’« humour ».
Il est, semble-t-il, le véritable esprit de la cour de la Lunéville, jusqu’à ce que celle-ci ne se disperse aux quatre vents après la disparition en 1766 de Stanislas et la rattachement définitif de la Lorraine à la France.
Panpan demeure à Lunéville où, avec quelques amis fidèles, il entretient le souvenir de ce qui fut l’une des assemblées les plus brillantes d’Europe. Il y meurt en 1796, dans la plus grande modestie et l’oubli.
L’histoire plaît beaucoup à Marceau Valance, qui du récit que lui fait mon père retient un détail : Panpan s’amusait lui-même de son surnom au point d’en faire une signature sonore. Il appuyait souvent ses propos de deux coups de canne frappés au sol : « Pan ! Pan ! »
Ça lui plaît tellement qu’il décide de transposer ces deux coups de cannes dans la structure même de sa création : le fourrage à base de praliné ne sera pas fourré dans une coque, mais saisi entre deux fines feuilles de nougatine, et un enrobage de chocolat scellera le tout.
Dit comme ça, ça a l’air bête, mais c’est techniquement audacieux et même difficile.
Marceau fait de nombreux essais avant de trouver la bonne recette. Et il doit faire fabriquer un moule spécial, adapté à la forme ovale du chocolat et à sa technique de montage.
On le voit ici, en train de découper les feuilles de nougatines. (Et il a du chocolat plein les dents, le canaillou.) 

Le résultat ? C’est délicieux. Cela fait bien longtemps que je n’en ai pas mangé, mais il y a dans ce chocolat très spécial une harmonie surprenante entre le croustillant des feuilles de nougatine et l’onctuosité épicée du fourrage praliné.
Pendant ce temps-là, mon père s’amuse : il dessine l’étiquette qui sera appliquée sur chaque chocolat et le dessin qui ornera la boîte. Je me souviens avoir été avec lui admirer la belle maison de Panpan, qui existe toujours et dont il a dessiné la porte. J’avais 9 ans. 

Ah, il en a parlé, de Panpan ! Dans mon souvenir je devais avoir 15 ans environ. Je n’en avais que 9. Plus personne ne se souvient de l’année de la création de ce chocolat. J'ai appelé le fabricant de l’étiquette, qui a retrouvé la première commande, datée du 9 septembre 1983.
Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça – par ce fil bien long et poussif, je suis ce soir un peu fatigué et je vous prie de m’en excuser – en ce soir de Noël ?
Parce qu’il y a quelque temps, le nom de Panpan a été prononcé au secrétariat de rédaction de @lestrepublicain, où je travaille actuellement, dans le cadre d'un CDD de remplacement de congé maladie.
L’un de mes confrères, le très agile @J_Beneteau, qui alimente avec une grande maestria la rubrique « Le savez-vous ? » du site du journal, a eu vent de Panpan et en a fait un article, que vous pouvez lire ici. c.estrepublicain.fr/societe/2021/1…
Quand il en a parlé, je lui ai dit : « Panpan, c’est aussi un chocolat et c’est une histoire que je connais assez bien. » L’idée est venue d’en faire, pourquoi pas ? un article.
Julien m’a suggéré de le proposer à l’agence locale de Lunéville. Ce que j’ai fait. @AdelineAsper a accepté avec enthousiaste et m’a fait la grâce de 4 000 signes, un calibrage exceptionnel pour une édition locale. (J’ai donc coupé ma copie initiale de moitié !)
Et cet article est paru ce matin dans « L’Est républicain » en ouverture de l’édition de Lunéville. Je suis journaliste depuis treize ans ans et c’est (presque) la première fois que je publie quelque chose de « consistant ».
Une investigation chocolatière sans limites ni concessions digne des plus grandes enquêtes ! J’ai traqué l’info dans les papiers de feu mon père, chez les successeurs de Marceau Valance…
… chez sa veuve, aussi, la belle Françoise de 1958, qui va bien et m’a parlé des échanges enthousiastes et des bonnes rigolades entre son mari (décédé en 1999, cinq ans seulement après avoir vendu la pâtisserie pour une retraite bien méritée) et mon père.
Et chez le fabricant d’étiquettes, donc, la maison Berg, à Lunéville, qui existe toujours et qui a été la seule source à même de retrouver l’année de la création de ce chocolat.
Je n’ai pas dit à ma mère que cet article paraissait aujourd’hui. Elle l’a découvert ce matin, tandis que je dormais encore. Quand je me suis réveillé et que je suis descendu à la cuisine, je l’ai trouvée… émue.
J’ai eu peur que quelque chose lui ait déplu. Elle m’a dit la plus belle chose qu’on eût pu me dire : que mon père aurait été, en lisant, cet article, fier de moi.
(La galerie photo est là.)
c.estrepublicain.fr/societe/2021/1…
c.estrepublicain.fr/societe/2021/1…
(L’article est un peu plus digeste que ce fil bien trop long, promis !)
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh