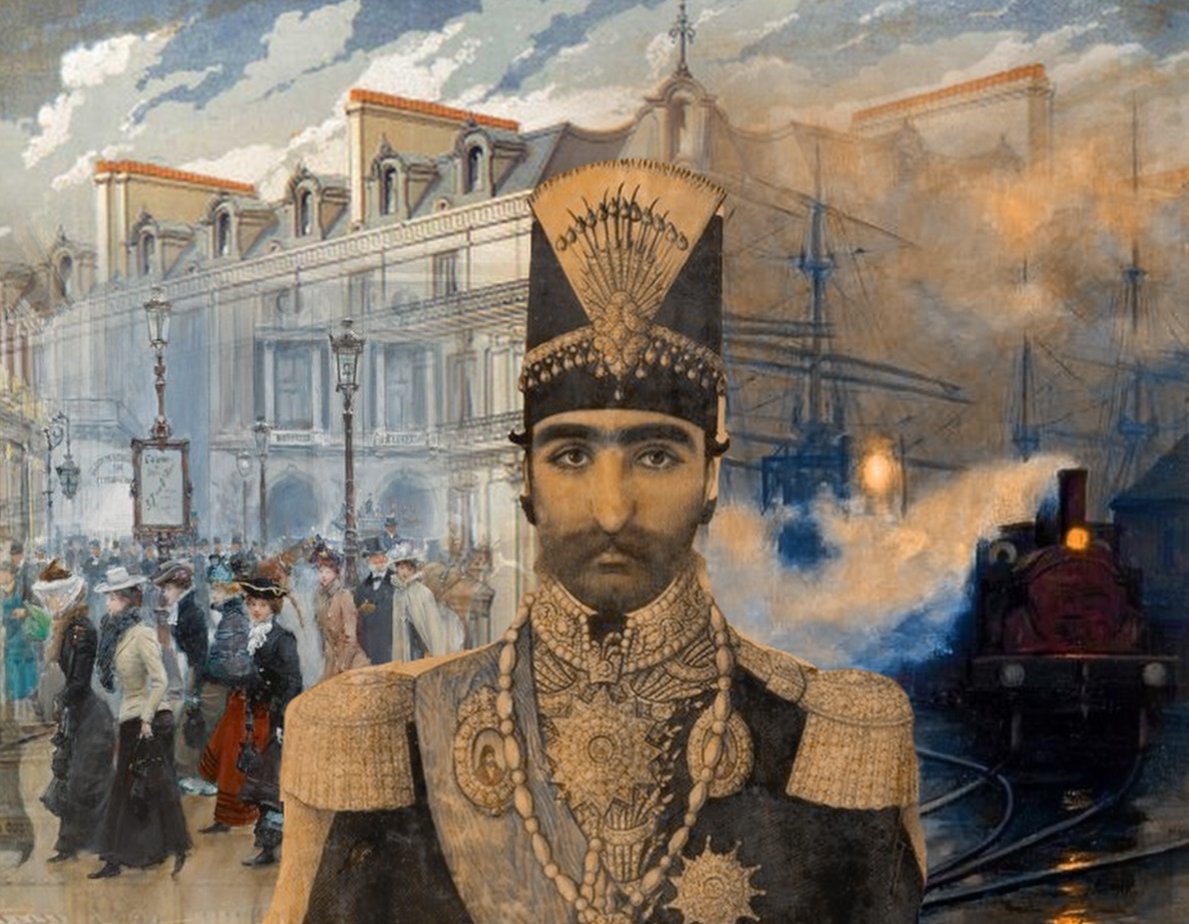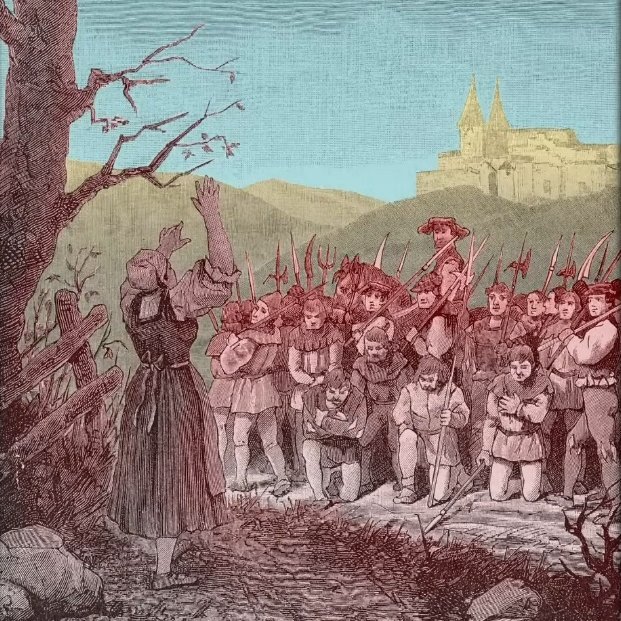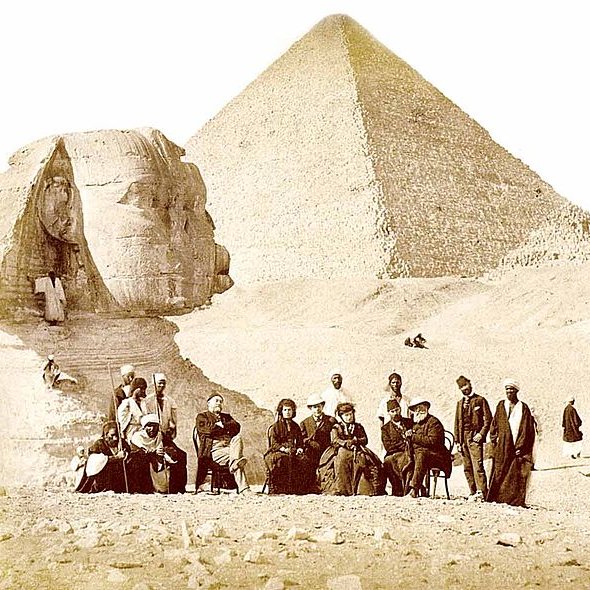Le 18 juin 1815 marque la défaite de Napoléon dans la morne plaine de Waterloo.
Les troupes britanniques de Wellington et les troupes prussiennes de Blücher y remportent une victoire décisive.
Retraçons les événements de la journée. 1/11
Les troupes britanniques de Wellington et les troupes prussiennes de Blücher y remportent une victoire décisive.
Retraçons les événements de la journée. 1/11

8h00 : Les troupes britanniques de Wellington commencent à occuper leurs positions stratégiques sur les hauteurs de Mont-Saint-Jean.
Elle lui offre un avantage défensif, avec des pentes abruptes et des champs de blé qui gênent les manœuvres de l'infanterie ennemie. 2/11
Elle lui offre un avantage défensif, avec des pentes abruptes et des champs de blé qui gênent les manœuvres de l'infanterie ennemie. 2/11

11h30 : Les troupes françaises du maréchal Ney lancent des attaques contre les positions alliées, principalement dirigées vers le flanc gauche britannique.
Si les combats sont violents, les Britanniques tiennent bon malgré les assauts répétés. 3/11
Si les combats sont violents, les Britanniques tiennent bon malgré les assauts répétés. 3/11

13h00 : Les Français parviennent à prendre le château de Hougoumont après une lutte acharnée.
Cependant, les Britanniques, accompagnés de troupes néerlandaises, hanovriennes et Brunswickoises, résistent fermement dans d'autres secteurs du champ de bataille. 4/11
Cependant, les Britanniques, accompagnés de troupes néerlandaises, hanovriennes et Brunswickoises, résistent fermement dans d'autres secteurs du champ de bataille. 4/11

14h30 : Les troupes françaises attaquent la ferme de La Haye Sainte, une position clé du dispositif allié.
Les Britanniques, sous le commandement de William MacDonell, défendent vaillamment la ferme, résistant aux assauts français et infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. 5/11
Les Britanniques, sous le commandement de William MacDonell, défendent vaillamment la ferme, résistant aux assauts français et infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. 5/11

16h00 : Les Français lancent une attaque massive sur le centre des positions alliées, cherchant à briser les lignes britanniques et à les diviser.
Les Britanniques forment des carrés défensifs compacts pour résister à la cavalerie française et maintenir leur position. 6/11
Les Britanniques forment des carrés défensifs compacts pour résister à la cavalerie française et maintenir leur position. 6/11

18h00 : Les Prussiens, sous le commandement du général Blücher, arrivent inopinément sur le champ de bataille et attaquent l'aile droite des troupes françaises, créant une nouvelle pression sur Napoléon et ses troupes. 7/11 

19h00 : Les troupes françaises, épuisées et confrontées à des attaques combinées des Alliés britanniques et prussiens, commencent à fléchir.
La Garde impériale n'y changera plus rien. Les lignes françaises sont enfoncées et la situation devient critique pour Napoléon. 8/11
La Garde impériale n'y changera plus rien. Les lignes françaises sont enfoncées et la situation devient critique pour Napoléon. 8/11

20h00 : Napoléon ordonne la retraite générale, reconnaissant que la bataille est perdue. Les forces françaises se retirent du champ de bataille et les troupes britannico-prussiennes poursuivent leur avantage. 9/11 

Les mauvaises conditions climatiques du terrain ont joué en défaveur des Français.
Les témoignages de tous les corps d’armée (français, belgo-hollandais, etc) mentionnent les difficultés rencontrées (conditions pluvieuses, etc). Cela ne fut, toutefois, pas déterminant. 10/11
Les témoignages de tous les corps d’armée (français, belgo-hollandais, etc) mentionnent les difficultés rencontrées (conditions pluvieuses, etc). Cela ne fut, toutefois, pas déterminant. 10/11

Pour en savoir plus :
- waterloocommittee.be/battle.php?vie…
- napoleon.org/magazine/lieux…
- lefigaro.fr/histoire/2015/…
#Waterloo 11/11
- waterloocommittee.be/battle.php?vie…
- napoleon.org/magazine/lieux…
- lefigaro.fr/histoire/2015/…
#Waterloo 11/11

• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh